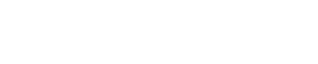Cochons et cuirassés
Elephant Films a eu la bonne idée de faire profiter en cette fin d’année de trois films réalisés par Shohei Imamura, occasion de revenir sur la trajectoire et la jeunesse de celui qui fut un maître d’œuvre de la nouvelle vague japonaise des sixties et que l’on connaît surtout pour ses derniers succès palmes à l’appui, LA BALLADE DE NARAYAMA et L’ANGUILLE. Succédant à la génération des Ozu-Mizoguchi-Kurosawa (il a été l’assistant du premier), Imamura appartient avec Oshima, Shinoda et Yoshida à ce courant ayant débuté à la fin des années 50 et pris son ampleur dans les années 60, courant baptisé nouvelle vague en hommage à la révolution cinématographique opérée chez nous. Le parallèle n’est pourtant que de nom et le terme sert à regrouper au Japon un ensemble de cinéastes et une tendance commune à s’écarter des drames intimistes et familiaux à la Ozu pour regagner le terrain d’une réalisme social et critique.
S’il n’en est pas le représentant le plus flamboyant, à l’inverse d’un Oshima plus virulent et contestataire, Imamura en représenterait peut-être un versant plus complexe et subtil. Par sa volonté d’indépendance notamment qui le fait débuter presque par hasard comme assistant d’Ozu, puis passer au studio de la Nikkatsu où il réalise quelques films sous contrainte. C’est en quittant les studios de la Nikkatsu pour fonder sa propre maison de production – Imamura productions – qu’il prend son véritable envol. C’est après ce moment-là que se situent les œuvres proposées par le coffret d’Elephant films comprenant trois films inscrits durant la période des années 60 : COCHONS ET CUIRASSES (1961), LA FEMME INSECTE (1963) et LE PORNOGRAPHE (1966).
Le premier opus exprime ce geste de libération à la fois rageur et maîtrisé. Ayant profité du succès du GRAND FRERE, film sous influence de la Nikkatsu et couronné – cela n’arrange pas toujours – du prix de l’Education, Imamura peut quitter les œuvres de commande et affirmer sa réflexion critique. Inspiré par une recherche documentaire et influencé par le réalisme et la peinture sociale de Kurosawa (L’ANGE IVRE), il entreprend avec COCHONS ET CUIRASSES de faire le portrait d’un Japon au terme de la seconde guerre mondiale, occupé par les Etats-Unis et tentant de survivre par tous les moyens.
Le film suit ainsi les trajectoires d’abord unies puis divergentes de Kinta, une jeune frappe naïve vivant à la périphérie du gangstérisme de la mafia yakuza et rêvant de s’enrichir rapidement, et de son amie Haruko, une jeune fille aux tendances idéalistes que sa famille pousse plus ou moins à la prostitution mais rêvant d’une vie honnête. Gravitant autour de ces deux personnages principaux, s’adjoint une galerie de personnages secondaires à la fois pittoresques et pitoyables, empruntés sans doute à l’expérience d’Imamura (il a vécu quelques années dans le quartier de Shinjuku au milieu de la prostitution et du marché noir), parmi lesquels le chef se croyant condamné par une maladie et tentant de se suicider sans y parvenir, les sbires brutaux et imbéciles, le père de Kinta, patriarche traditionnaliste croyant dans la vertu du travail honnête et son opposé, la mère d’Haruko prostituant ses filles en les remettant aux mains de riches Américains. Au trafic des corps s’ajoute celui de l’argent : les cochons du titre nourris par les restes de la base américaine sont au centre du marché noir et servent également à dissimuler les activités criminelles des gangs, notamment le racket.
Dès le très beau plan introductif – un plan-séquence glissant de la base américaine aux rues illuminées d’un quartier de plaisirs dans la ville de Yokozuka – Imamura installe un réalisme distancié, à la fois rageur et teinté d’ironie. La théâtralité de la perspective cavalière transforme le quartier en laboratoire expérimental et scène où se rejoue l’échange des corps et de l’argent. Les soldats américains ivres sont poussés dans les bars et les bordels par le jeune Kinta, représentant ici d’un Japon vaincu, soumis aux volontés de son maître mais rêvant d’une impossible libération (le dragon sur le blouson du héros). L’emploi du scope par Imamura image un Japon à la fois grouillant et sordide, un labyrinthe chaotique et presque cauchemardesque auquel les protagonistes tentent d’échapper sans succès. Tout ici pousse en direction du bas et vers l’animalité : les corps tombent dans l’ivresse, les filles s’écroulent sur les lits où elles sont poussées par la brusquerie des soldats, les victimes des gangsters s’effondrent, battues ou abattues. Le Japon est montré par Imamura comme un espace de décadence et de déchéance morale, le seul rappel à l’ordre et à l’honneur ancien étant incarné par le père de Kinta et traité par Imamura avec un clair obscur rappelant fortement Kurosawa.
Les moments de respiration n’en sont que plus précieux et ici, toujours reliés au personnage féminin rêvant seulement de quitter la ville : Haruko est la première représentante de ces femmes fortes cherchant à se libérer que va privilégier le cinéma d’Imamura ; voulant sauver Kinta de l’attraction fatale qui le conduira à devenir victime expiatoire des gangsters qu’il côtoie, elle l’amène dans les hauteurs et lui fait redécouvrir dans un instant presque lyrique la ville comme une cuvette sale et sordide. C’est également elle qui prendra le risque, au terme du film, d’aller à contre-courant de ces consoeurs en quittant la ville.
Mais dans l’espace clos de la base militaire – traité comme un enclos animal – les passions n’ont pas le temps de se déployer, sousmises aux calculs mesquins et inévitables d’une survie nécessaire. Sous le regard d’entomologiste d’Imamura, les hommes accomplissent leur métamorphose animale : un cadavre de yakuza est remplacé par une portée de chiens et les victimes finissent dévorées par des cochons qui serviront de nourriture aux hommes. Les « cochons » du titre, ce sont les Américains mais tout autant les Japonais eux-mêmes se cannibalisant, abdiquant leurs anciennes valeurs et s’enfermant eux-mêmes dans la prison de leur soumission.
Une telle description pourrait amener Imamura du côté d’un réalisme à tendance naturaliste. Mais à cet observateur impitoyable de la nature humaine s’adjoint également un esthète distancié, n’hésitant pas à tirer sa mise en scène du côté du grotesque, de la satire ou d’un tragique retenu (le viol d’Haruko). Quel espoir reste-t-il encore aux héros, une fois parcouru le cercle des désillusions ? A Kinta, l’héroïsme d’un sacrifice final sur la scène au milieu d’un décor dont il n’a fait jusque là que parcourir les coulisses ; à Haruko, la voie d’une résignation morale et courageuse. C’est peut-être encore une des richesses propres à Imamura que de refuser les facilités de l’idéologie politique et varier les tonalités dans sa mise en scène. On y plonge pour suivre ces personnages aveugles à leur destin ; sans sympathie mais sans les juger, Imamura accomplit son travail d’entomologiste. Il filme comme frappe le vampire de Baudelaire : sans colère et sans haine.
Téléchargez les anciens numéros de Sueurs Froides
Inscrivez-vous à la liste de diffusion et accédez au
téléchargement des anciens numéros de Sueurs Froides :
- Une tranche d'histoire du fanzinat français
- 36 numéros de 1994 à 2010
- Près de 1800 films critiqués
Un index est disponible pour chercher un film ou un dossier
CLIQUEZ ICI.
- Article rédigé par : Stéphane Bex
- Ses films préférés :