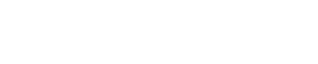Et le vent apporta la violence
Après avoir purgé une peine de dix ans de travaux forcés, Gary Hamilton est libéré pour bonne conduite et au regard de son passé militaire exemplaire. L’homme n’a qu’une idée en tête : se venger de celui qui l’a fait condamner à sa place, l’a dépossédé de ses biens et lui a subtilisé sa femme au passage ! Hamilton apprend que son ennemi juré, Acombar, règne en véritable seigneur sur une petite ville vers laquelle il se rend donc les armes à la main. Son arrivée coïncide avec celle d’une tempête et l’ex condamné devra, pour atteindre son but, se confronter tout d’abord aux dizaines d’hommes armés qui protègent Acombar, reclus dans sa magnifique villa…
On ne présente plus l’excellent mais toujours un peu sous estimé Antonio Margheriti (alias Anthony Dawson), réalisateur, producteur et spécialiste des effets spéciaux parfois surnommé le « Corman italien ». Décédé en 2002, cet artisan majeur du cinéma populaire transalpin a tourné une cinquantaine de films, illustrant souvent avec talent ses genres principaux : la s-f (SPACE MEN, 1960), le péplum (LES GEANTS DE ROME, 1964) ou l’épouvante, signant notamment deux chefs d’œuvre avec Barbara Steele en 1964 : LA DANSE MACABRE et LA SORCIERE SANGLANTE. Si Antonio Margheriti a également œuvré dans le giallo, le polar et le western, c’est assurément dans le fantastique qu’il a le mieux exprimé son talent, n’hésitant pas à perpétuer une tradition gothique en complète désuétude dans les années 70 (son très beau remake en couleurs de DANSE MACABRE : LES FANTOMES DE HURLEVENT, 1971 ; le très plaisant 7 DEATHS IN A CAT’S EYE, 1973…) ou à nourrir d’éléments fantastiques un genre en principe peu perméable à cet univers : le western. Lorsque notre réalisateur s’intéresse au « filon » initié par Sergio Leone dès 1964, celui-ci semble déjà presque épuisé après avoir offert quelques titres fulgurants lors des quatre années qui suivirent (DJANGO de Sergio Corbucci, 1966 ; LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND de Sergio Leone, 1966 ; LE DERNIER FACE A FACE de Sergio Sollima, 1967 ; LE GRAND SILENCE de Sergio Corbucci, 1968). Sur la demi-douzaine de westerns tournés par Antonio Margheriti, ET LE VENT APPORTA LA VIOLENCE est très probablement le meilleur mais aussi un des titres les plus intéressants de son impressionnante (et inégale) filmographie.
Le long métrage s’inscrit tout d’abord dans le registre ultra-codifié du « film de vengeance », sous-genre fréquemment utilisé dans le western classique américain et que les Italiens ont exploité de façon quasi-systématique sous des formes plus (IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST de Sergio Leone, 1968) ou moins (LA MORT ETAIT AU RENDEZ-VOUS de Giulio Petroni, 1967) novatrices. Cette thématique, qui est également un des ressorts essentiels du cinéma d’action, était déjà à l’œuvre dans le précédent western d’Antonio Margheriti, AVEC DJANGO, LA MORT EST LA (1968) dont le titre anglais se contentait d’un catégorique VENGEANCE ! ET LE VENT APPORTA LA VIOLENCE se démarque cependant de la plupart de ses confrères transalpins qui sont souvent reconnaissables à leur hypertrophie visuelle, à leurs excès sanglants et à l’ambiguïté forcenée de leurs personnages. Le film propose en effet une trame narrative marquée par l’épure, un certain manichéisme concernant ses protagonistes et un sens de la mesure plutôt classique pour ce qui touche aux « gun-fights » et autres séquences potentiellement graphiques. Ce classicisme formel trouve un écho dans le dispositif global du long métrage et son respect des trois unités propres au théâtre avec lequel il partage un même sens de l’abstraction en ayant notamment recours à des « décors » à la fois irréels et symboliques. L’autre contre-pied que se permet Antonio Margheriti est de confier le rôle du héros-vengeur au sinistre Klaus Kinski, abonné aux personnages patibulaires dans les westerns italiens : l’acteur allemand venait d’incarner Tigrero, véritable « ange de la mort » dans LE GRAND SILENCE. Beaucoup moins convaincant dans la peau d’un « gentil », on peut lui préférer son antagoniste interprété par Peter Carsten (LE DERNIER TRAIN DU KATANGA de Jack Cardiff, 1968), traître aux allures nobles, entièrement dévoué à l’amour filial et qui rappelle lointainement le personnage du prince déchu joué par Burt Lancaster dans LE GUEPARD (1963) de Luchino Visconti. Si l’intrigue progresse de façon un peu mécanique et linéaire, accumulant sans surprise les séquences où Hamilton se débarrasse sans mal de la garde rapprochée d’Acombar avant d’affronter ce dernier seul à seul, le traitement formel de ce règlement de comptes en forme d’hécatombe est quant à lui tout à fait remarquable. Comme il l’avait fait pour le finale de son précédent western (une longue course-poursuite dans de sinistres galeries souterraines), Antonio Margheriti convoque ici une imagerie et des thèmes qui ressortissent au genre du fantastique-gothique, créant de ce fait un prototype d’hybride tout à fait unique. C’est en effet dès l’entrée d’Hamilton dans la petite ville quasi-déserte que des éléments propres au cinéma d’épouvante sont mis en place : cadre nocturne (qui sera celui de presque tout le film), arrivée d’une tempête prophétisant la vengeance destructrice du héros et transformant l’espace filmique en univers spectral. L’adjectif convient également parfaitement à Hamilton, véritable figure fantomatique apparaissant puis disparaissant de manière presque surnaturelle après avoir abattu quelques « gunmen » ; le revenant (au sens propre et figuré, donc) investit de fait des lieux emblématiques de la tradition gothique : un réseau souterrain aux allures de crypte immense ou les recoins d’une sinistre chapelle. Si le réalisateur joue beaucoup sur la nature invisible de son protagoniste et fait du hors-champ un espace essentiel, il sature en revanche sa fiction d’éléments auditifs récurrents qui viennent appuyer son atmosphère de cauchemar : le souffle incessant du vent, le tintement lugubre d’une cloche et les coups de feu retentissant dans la nuit sont autant d’illustrations sonores de l’aspect fantastique de la vengeance de son héros. Celle-ci revêt finalement une dimension fortement symbolique et se nourrit de références religieuses depuis le titre original du film (« Et dieu dit à Caïn…) jusqu’à la toute puissance du « justicier » dont la mission (éradiquer le Mal) semble guidée par une main divine. ET LE VENT APPORTA LA VIOLENCE transcende donc complètement son statut de western de série B en apportant à sa ligne claire une densité et une originalité qui vont chercher leur source dans le métissage des genres et dans une discrète recherche d’abstraction.