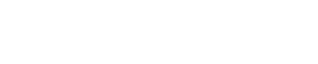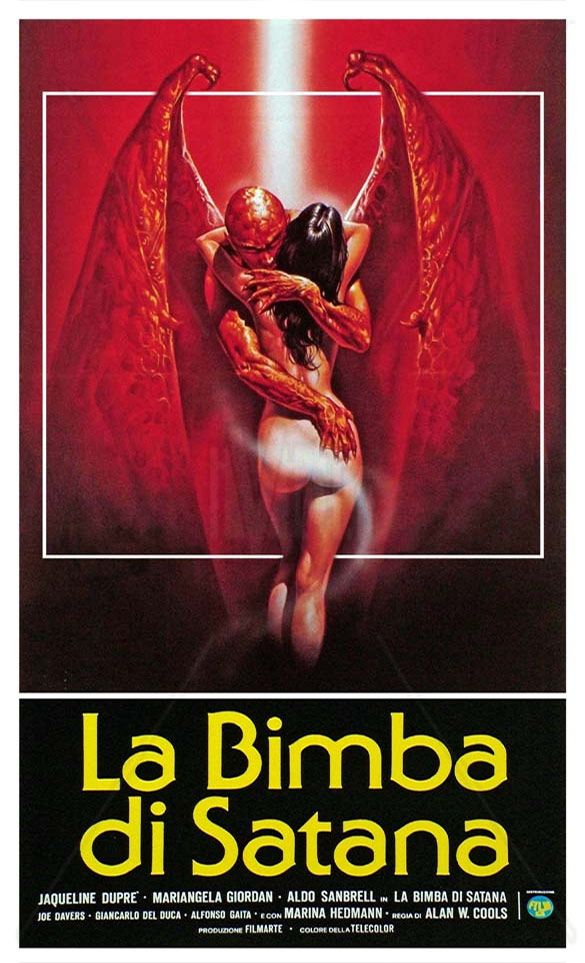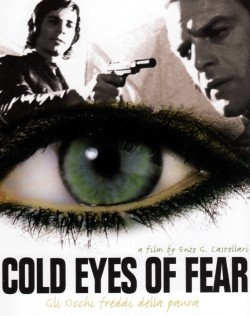FESTIVAL ZOOM ARRIERE – TOULOUSE
FESTIVAL ZOOM ARRIERE
10ème édition pour ce festival attirant toujours plus de monde et centré cette année autour des questions de restauration. De nombreux invités présents qui soulignent la dimension européenne d’un mouvement de restauration dont Franck Loiret, directeur délégué, rappelle que la Cinémathèque de Toulouse fut en partie l’instigratrice dès 2007. Et une programmation qui joue la part belle à la métaphore autour de ces films perdus et retrouvés, et que l’on aime d’autant plus que l’on croyait ne plus jamais les revoir. De nombreux ciné-concerts ponctuent le festival, offrant un éventail large de pratiques musicales – classicisme ou décalage – et de formations – accordéon, piano, trio – permettant de sortir des stéréotypes habituels accolés à la musique sur les films muets. Il faut souligner enfin l’envergure du festival qui se déploie à la fois dans Toulouse et hors les murs et inclut un jury de jeunes lycéens invité à récompenser une oeuvre et une sélection réservée aux plus jeunes. Le cinéma est de tout temps pour tous les âges.
Compte-rendu jour par jour.
Jeudi 31 mars.Premier coup d’envoi du festival avec en hommage à Wes Craven le moins bien connu mais passionnant EMPRISE DES TENEBRES (THE SERPENT AND THE RAINBOW), allégorie politique au pays du vaudou et des tontons Macoutes ; l’allégorie est également cinématographique : la magie du vaudou qui ressuscite les morts est aussi celle du cinéma qui restaure ses oeuvres passées.
Vendredi 1er avril. Après le rappel bienvenu du rôle institutionnel et de la nécessité culturelle de conserver et restaurer un patrimoine menacé, le mélodrame de Marcel L’Herbier, EL DORADO, vient faire la véritable ouverture du festival. Cette œuvre de commande taillée pour un succès populaire est cependant transcendée par l’impressionnisme expérimental et l’avant-gardisme du réalisateur qui y déploie, trois ans avant l’INHUMAINE, un jeu subtil de coloris à travers l’utilisation des teintes ou encore le fameux “flou tramé” qui provoqua la colère de Léon Gaumont croyant avoir affaire à un mauvais opérateur. Sibilla, l’héroïne incarnée par Eve Francis, adopte sans surprise les traits habituels du personnage mélodramatique. Fille mère, danseuse dans un cabaret, un baile andalou nommé l’El Dorado, elle cherche auprès d’un ancien et riche amant, Estiria, de l’aide pour secourir son fils qui se meurt à l’étage et dont Estiria est le père. Reniée, la jeune femme se venge en mettant en péril le mariage d’Iliana, la fille d’Estiria, en la poussant dans les bras d’Hedwick, un artiste pour lequel elle sert de modèle. Sous l’intrigue convenue, L’ibérophile L’Herbier multiplie les audaces narratives, les recherches de cadre et les variations psychologisées des teintes. L’atmosphère mystérieuse qui se dégage l’Alhambra de Grenade et l’utilisation des contrastes et du contre-jour faite par L’Herbier, pourrait anticiper la beauté exotique et artificielle de la mission espagnole dans le SUEURS FROIDES (VERTIGO) d’Hitchcock ; l’hallucinante scène finale aux accents shakespeariens fait du monde un théâtre de fous dans lequel Eve Francis entame une saisissante et désespérée danse de mort avant de se poignarder sur le fond d’un écran où s’agitent des ombres désarticulées. L’El Dorado est un mythe, le plus commun de tous, celui qui s’accomplit sur le devant de la scène ou sur le front des écrans et dont les coulisses dissimulent la misère et les contingences sordides.
Restauré depuis 1995, présenté à Toulouse par Manuel Padoan, la directrice de Gaumont Pathé Archives, le travail accompli sur EL DORADO fait ici heureusement suite à la seconde version restaurée de L’INHUMAINE présentée en 2015 et qu’on doit à la société Lobster Films. Il est essentiel de rappeler pour finir la beauté et la précision du travail mené par le musicologue Michel Lehman qui accompagnait au piano le film de L’Herbier et remplaçait la partition originale de Marius François Gaillard que l’on peut retrouver sur le DVD.
Samedi 2 avril. Le GRIBICHE, conte social tourné plus de 60 ans avant LA VIE EST UN FLEUVE TRANQUILLE de Chatiliez met en scène l’adoption plus ou moins forcée par une riche Américaine d’un jeune garçon populaire particulièrement prometteur et vertueux. Si le film montre que l’on ne change pas si aisément de classe sociale, le film en revanche s’amuse des registres, balançant entre la comédie, le mélodrame et sa parodie. Oeuvre plus légère que la monumentale et pharaonique ATLANTIDE, GRIBICHE s’avère une réussite toute en subtilité, prenant le temps de justifier les atermoiements et la révolte de son héros sans verser pour autant dans les clichés. Le suit LES DULCINEES D’UN VIEIL APACHE de Svatopluk Innemann tourné dans l’entre-deux-guerres, sympathique et exubérante comédie tchèque dans laquelle un mariage forcé sert de trame à un jeu de quiproquos burlesques oscillant entre Chaplin et les Marx Brothers. A noter la présence au générique de la délurée Anny Ondra, star du cinéma tchèque que l’on retrouvera dans CHANTAGE, un des premiers Hitchcock. C’est ce dernier que l’on retrouve le soir même avec THE PLEASURE GARDEN, un des premiers mélodrames du réalisateur restauré par le BFI et présenté ici par Kieron Webb, conservateur au BFI venu rappeler le plan de sauvetage lancé pour retrouver et restaurer les sept premiers films du maître. En suivant le parcours méandreux de deux danseuses de music-hall et à partir d’une trame qui rappelle déjà le futur SHOW GIRLS de Verhoeven, Hitchcock bâtit un film romanesque, jouant de contrepoints géographique ou social, éteignant ainsi dans le va-et-vient entre les deux héroïnes la menace des stéréotypes. La restauration de la copie qui a permis de gagner un quart d’heure sur la version précédente permet de nuancer et colorer plus subtilement les traits annonçant les oeuvres futures : populisme joyeux et décomplexé à travers un couple de logeurs, perversité sexuelle dans le lesbianisme implicite entre les deux femmes ou encore usage ironique du symbole avec une pomme à peine croquée pour illustrer une nuit de noces.
Changement de registre ce même jour avec Cédric Klapisch venu présenter le programme Cinetek, « la Cinémathèque des réalisateurs » avec deux oeuvres du répertoire : UN SINGE EN HIVER de Verneuil et DO THE RIGHT THING de Spike Lee. De la côte normande à Brooklyn, d’une errance nocturne à un jour brûlant, de la biture monumentale au déraillement de la violence, des dialogues ciselés d’Audiard au parler imagé des communautés de Brooklyn, se jouent le grand écart culturel et l’assimilation secrète. Dans les deux cas, on retrouve le même amour d’un cinéma qui colle aux situations et aux êtres et dont on saisit la valeur modélisante pour Klapisch. Rappelons que la Cinetek, projet dont Klapisch est l’instigateur avec Laurent Cantet et Pascale Ferran, a ouvert son catalogue fin 2015 et qu’une trentaine de cinéastes se sont prêtés au jeu de la liste. Une autre manière d’accompagner le travail de préservation et de restauration et de donner accès à des chefs d’oeuvre ayant eu un rôle véritablement séminal.
Dimanche 3 avril. Retour au cinéma tchèque avec ADELE N’A PAS ENCORE DINE (1977), oeuvre loufoque et jubilatoire que l’on doit au tandem Oldrich Lipsky à la réalisation et Jiri Brdecka au scénario, déjà auteurs de JOE LIMONADE, une parodie de western. Hommage avoué aux aventures de Nick Carter et aux serials du début du siècle, l’oeuvre déploie sa verve feuilletonesque avec un goût prononcé pour les machineries retro-futuristes et un léger psychédélisme de la couleur et des motifs (notamment avec la plante carnivore éponyme tout droit sortie de LA PETITE BOUTIQUE DES HORREURS). La version restaurée permet de redécouvrir toute l’exubérance de cette petite pépite qui ne se prend jamais au sérieux.
Duvivier ensuite avec LA FIN DU JOUR occasion de retrouver LA BELLE EQUIPE dans une version noire et crépusculaire. La vie quotidienne d’un asile pour vieux comédiens, l’abbaye de Saint-Jean-la-rivière, se voit bouleversée lors de l’arrivée de Saint-Clair (Louis Jouvet), homme à femmes et rival de Marny (Victor Francen). Ce sera le médiocre Cabrissade (Michel Simon), souffleur chimérique, qui en fera les frais. La version restaurée en 4K par L’immagine Ritrovata permet de mettre enfin en valeur la photographie de Christian Matras, le directeur photo de Max Ophüls. Ambiances de film noir, brouillard fantastique régnant sur le cimetière final, la déclaration d’amour sans pitié de Duvivier au théâtre et aux comédiens retrouve dans sa photogénie l’éclat d’un joyau noir, jusque là réservé à la brillance des dialogues. On peut y lire également l’allégorie des oeuvres cinématographiques et de leur restauration qui leur procure, au contraire de ces comédiens crevés de nostalgie, une seconde jeunesse inespérée.
Magie du cinéma mais diabolique celle-là avec l’éblouissant RAPSODIA SATANICA (1915) de Nino Oxila dont l’intrigue se nourrit de thèmes faustiens : pour retrouver une seconde jeunesse, la comtesse Alba d’Oltrevita (la diva Lyda Borelli) signe un pacte avec Méphisto, ouvrant ainsi la porte à un récit dramatique et à une conclusion tragique. Si RAPSODIA SATANICA brille avec autant d’incandescence, c’est en tant qu’oeuvre d’art totale, puisant au romantisme wagnérien comme aux acquis de l’avant-garde et plus spécifiquement à la picturalité du préraphaélisme et à l’esthétique d’annunzienne de l’Art Nouveau. Cinéma possédé que celui-là qui montre peut-être la première des stars à l’écran en l’enfermant dans un paradoxe fictionnel puisque l’héroïne incarne une vieille femme retrouvant illusoirement sa jeunesse, c’est-à-dire son corps réel d’actrice starifié. Le réel est ainsi au service de l’illusion comme le corps est au service de la transe qui le prend – saisissante scène de presque somnambulisme à la fin du film – et l’esthétique du cinéma au service du diable qui en donne les règles, ainsi que pourrait le dire Epstein. Le travail de restauration en 4K offre, contrairement à Méphisto, une jeunesse qui n’est pas illusoire et l’occasion de voir un objet artistique à l’esthétique unique puisque, pour la première fois, aux teintes du film s’ajoutent les couleurs des pochoirs faites à la main.
Achevant apocalyptiquement la journée, LE JOUR OU LA TERRE PRIT FEU (1961), de Val Guest, réalisateur de la Hammer et connu pour avoir tourné LE MONSTRE (QUATERMASS XPERIMENT) qui marque les débuts de la Hammer dans la science-fiction au cours des années 50, se donne comme une oeuvre sans prétention mais habile à tirer parti de son maigre budget. Le désastre naturel (un réchauffement planétaire dû à des essais nucléaires) s’inscrit dans le contexte de la paranoïa autour de la guerre froide mais résonne avec une thématique plus écologique aujourd’hui. Le héros, impénitent buveur et séducteur, journaliste talentueux mais ayant perdu la flamme, saura-t-il retrouver l’amour et le goût d’écrire ? Peu d’effets spéciaux ici mais un récit rythmé, s’appuyant sur l’urgence des situations journalistiques, un réalisme parfois quasi-documentaire, et quelques visions d’une Londres désertée évoquant LE MONDE, LA CHAIR ET LE DIABLE (1959) permettent à cette série B de faire encore aujorud’hui bonne figure.
Lundi 4 avril. Place en ce jour à une table ronde consacrée aux problèmes posés par la restauration. Après un premier état des lieux, le débat se porte inévitablement sur le rôle du numérique : doit-on en cette période de transition que nous vivons privilégier la conservation des pellicules – ce qui pose un problème de stockage – ou se fier à la magie du numérique dont les qualités et les possibilités (échantillonnage des couleurs par exemple plus large que celui proposé par la photochimie) ont été rappelées ? Ou encore envisager déjà le temps de l’après-numérique et commencer à en dessiner la carte ? Béatrice de Pastre, directrice des collections des archives françaises du CNC met en garde contre la solution du tout numérique et notamment avec le traitement automatique des logiciels risquant d’altérer l’aspect du film original au lieu de le restaurer. Comme le rappellera quelques jours plus tard Luciano Berriatua en présentant son travail sur FAUST, chaque travail de restauration doit s’accompagner d’une possible dé-restauration, permettant de défaire le travail accompli quand il s’écarte du résultat voulu et réentreprendre sur de nouvelles bases. A la manière de points de sauvegarde permettant de jalonner avec prudence un processus délicat. A ce problème s’ajoute encore celui des informations portées sur la pellicule et disparaissant lorsque le film est numérisé et que, dans certains pays européens, cette numérisation s’accompagne d’une élimination de l’original nitrate. La restauration rappelle Joël Daire, parlant au nom de la Cinémathèque française, s’accompagne d’un travail de recherche conséquent, à la fois exigeant mais également modeste, puisqu’il doit s’inscrire dans une forme de transmission continue. Il n’y a pas de restauration définitive. Mais la restauration pose aussi des problèmes économiques, comme le souligne Sophie Seydoux, présidente de la Fondation Jéröme Seydoux-Pathé, et exige des ressources financières et temporelles importantes : souvent plusieurs années pour des budgets qui avoisinent parfois 300000 euros. Des premiers inventaires du matériel jusqu’au retirage des films sur pellicule, en passant par le nettoyage et la scannerisation, les étapes diverses du processus sont rappelées ainsi que les problèmes éthiques qu’elles peuvent soulever : le processus de restauration doit-il constituer également un processus d’amélioration ? La course au zéro défaut est-elle une nécessité ? Il importe de sauvegarder avec le film, rappelle Manuela Padoan, les limites technologiques qui font partie également de l’histoire du cinéma. Mais précisément, quel rôle jouent les restaurateurs dans cette histoire dont ils choisissent les acteurs ? Quels sont les critères qui doivent décider qu’un film a droit ou non à sa restauration ? La situation recoupe grosso modo les questions soulevées par la programmation des oeuvres : faut-il montrer le plus possible ou opérer un choix rationnel entre les oeuvres ? Et qui est à même d’en fixer les règles ? Le problème est donc loin d’être tranché et plus que jamais les participants ont rappelé combien il était nécessaire de rester prudents pour mieux pouvoir anticiper les situations à venir.
Comme un écho en clin d’œil à la table ouverte de l’après-midi, la BELLE EQUIPE de Duvivier, en version restaurée 4K par L’immagine Ritrovata pour Pathé est présentée par Sophie Seydoux. Echo encore à l’état des lieux de la restauration ? Le film de copains façon Verneuil, tourné en plein front populaire et commencé comme la joyeuse et libre errance d’une bande de potes s’accompagne d’un dénouement plus amer. Le rêve n’est pas si rose et les dissensions s’accumulent au fur et à mesure que l’intrigue progresse. Il y a quelque chose de pourri au royaume des guinguettes et Gabin a beau pousser la chansonnette , on sait que les lendemains déchantent. Le film est ici présenté avec sa fin pessimiste, celle que souhaitait Duvivier, mais remplacée par une fin plus optimiste demandée par les producteurs et choisie pour l’exploitation du film jusqu’en 2006.
Mardi 5 avril.Double programme Epstein avec L’OR DES MERS (1932) et LE TEMPESTAIRE (1947), deux oeuvres du cycle breton mariant le réalisme ethnologique et le merveilleux poétique restaurés par la Cinémathèque française à partir de 2013. Entre les deux , la guerre et la menace qui pèse sur Jean Epstein l’ont encore plus confiné dans une marge artistique entamée lors de son éloignement des studios et ses recherches expérimentales. Si les deux films s’opposent par le traitement du cadre (intérieurs claustrophobiques pour le premier ; extérieurs pour décrire la tempête déchaînée dans le second), il s s’alimentent tous deux à la même source d’un légendaire merveilleux avec la découverte d’un trésor ici et le pouvoir d’un siffleur du vent là, capable d’apaiser l’élément maritime. Le cinéma d’Epstein n’est pas un cinéma de la croyance (celle qui concerne l’illusion cinématographique) mais un cinéaste du signe et de sa magie et l’offrande par la jeune femme inquiète du symbole chrétien au vieux tempestaire en est le symbole miraculeux. Cet acte qui inverse le sens historique (le christianisme fondé sur les légendes) libère les forces permettant de remonter le temps. Le travail d’Epstein d’arrachement du merveilleux au sein du réel s’opère en plaçant les images sous le signe de la dimension temporelle : les ralentis psychologiques, le renversement de la causalité historique – une mer retire ses vague, un corps s’arrache à la boue – sont des miracles esthétiques qui libèrent le regard de ses oeillères et l’esprit de la fausse logique des préjugés. Cinéma animique que celui d’Epstein retrouvant par le jeu temporel le langage secret où s’équivalent mystiquement les êtres et les choses.
La satire de l’Italie des années 60 se fait à la fois féroce et tendre sous le regard de Dino Risi avec LES MONSTRES, un film à sketches sorti un an seulement après LE FANFARON. Ce chef d’oeuvre de la comédie italienne, déclaration d’amour à un duo de comédiens (Ugo Tognazzi et Vittorio Gassman), est aussi une ode jubilatoire au mensonge et à l’art de l’acteur. Entre comédie bouffonne et étude classique de caractères et de types, grande comédie qui se déguise sous les atours de la farce, LES MONSTRES offre la galerie variée de têtes, à la manière d’antiques grotesques.
Mercredi 6 avril. Séance dramatique avec WHEN THE EARTH TREMBLED (1913) de Barry O’Neil, peut-être premier film catastrophe de l’histoire du cinéma, et TRAGICO CONVEGNO (1915), un mélodrame d’Ivo Illuminati, dont seulement deux bobines ont été retrouvées. Paradoxalement, la reconstitution minutieuse par O’Neil, aidé par des documents d’archive, du séisme qui ravage San Francisco en 1906, s’avère autant dramatique qu’involontairement comique. L’effondrement des murs dans lesquels se révèlent alors le décor, la théâtralisation du jeu de l’actrice prenant la pose quand tout s’écroule, renvoient la fiction à son caractère cinématographique et à son esthétique burlesque. La destruction est d’abord spectacle et spectacle de terreur avant tout. Curieusement, certaines scènes préfigurent déjà le 2012 de Roland Emmerich. A presque un siècle de distance, l’apocalypse est celle du cinéma qui n’en finit pas de faire trembler ses images. Moins de burlesque en revanche pour le mélodrame d’Illuminati qui évoque le difficile amour entre Maria, une jeune fille d’à peine 18 ans, et Lucien un aristocrate qui la regarde encore comme une enfant. Restauré comme le premier grâce à l’EYE FILM Institute, TRAGICO CONVEGNO est complété par un ensemble de documents achevant, par un beau mouvement de documentation poétique, le mélodrame dans le geste d’une esquisse abstraite.
Précédant la projection du FAUST de Murnau, une master class proposée par Luciano Berriatùa, spécialiste du réalisateur, met en avant les choix difficiles qui s’imposent à tout réalisateur. Rappelant les différents qui opposaient Murnau et Carl Hoffmann, le directeur de photographie, la présence de plusieurs caméras sur le tournage, la technique de travail de Murnau à partir des improvisations comme les multiples versions du film destinées à l’exportation, Berriatua évoque son investigation européenne et, preuve à l’appui défend sa position consistant à prendre chaque fois qu’un choix est nécessaire le parti de Murnau. La restauration se fait ici recréation et Berriatua sous-entend que les choix, toujours difficiles, ne peuvent s’opérer sans une règle esthétique directrice – celle ici de rivaliser pour ainsi dire avec le cinéaste et de se mettre « dans sa peau ». Si on peut émettre quelques réserves de la présentation de FAUST comme le chef-d’oeuvre absolu de Murnau -mais tel était le jugement du réalisateur, il faut reconnaître cependant que la version restaurée après un travail titanesque est une splendeur rendant à l’oeuvre sa profondeur picturale et son influence romantique autant qu’expressionniste comme le rappelle Rohmer, égratigné au passage d’ailleurs par Berriatua. Le drame métaphysique de la lumière et de l’ombre ouvrant et fermant l’oeuvre se modèle ici musicalement dans un jeu savant de clair-obscur faisant écho à NOSFERATU comme « symphonie du gris ». Du ciel à la terre, de la peste noire à la blancheur d’un hiver neigeux, du tragique au comique en passant par le drame, Murnau embrasse un monde par la force d’une foi poétique et un geste artistique associant la vision spectaculaire – le survol d’une ville – avec le drame le plus intime – les bouleversantes larmes d’une Gretchen martyrisée.
Vendredi 8 avril. Poursuite après la projection de L’ARMEE DES OMBRES de Melville et RAJA de Jacques Doillon de la carte blanche accordée à Pascal Greggory avec LE MIROIR de Tarkovski et NUIT DE CHIEN de Werner Schroeter. Deux films dans lesquels l’acteur joue, deux autres dans lesquels il eût aimé jouer. L’acteur se faisant présentateur et répondant au public lors d’une recontre la veille, rappelle avec une générosité pudique les grandes étapes de son parcours : une enfance bourgeoise dont il va se séparer en assumant des choix plus marginaux, la rencontre avec Téchiné et Rohmer ; le « désert » qui suit sa redécouverte par Chéreau en Pygmalion qui le mettra devant la caméra et sur les planches dans une pièce de Koltès. Multipliant les succès, se forgeant à coup d’exercices un corps nouveau, à la fois dur et juvénile, multipliant les registres et les expériences cinématographiques, entre Besson pour JEANNE D’ARC ou Ruiz dans LE TEMPS RETROUVE, Pascal Greggory a les allures d’un adolescent affable qui aurait vieilli sans s’en apercevoir et s’étonne de son succès. Jamais loin des failles, de cette figure d’homme blessé qu’il a incarnée si souvent, l’acteur se montre attentionné et rappelle que ce qui compte au cinéma, c’est l’amour : celui que les metteurs en scène ou réalisateurs portent aux acteurs, celui qu’il porte lui-même sur les oeuvres qui l’ont marqué.
Projection en ce même jour du JOLI MAI (1963) de Chris Marker et Pierre L’Homme, déclaration d’amour à Paris filmé au printemps 62 dans ce « premier printemps de la paix » vécu par la France gaulienne après les accords d’Evian. Rythmée par la chanson de Montand, cette balade d’un regard acéré fouillant à travers les couches sociales délivre le portrait d’une France qui se cherche, se trouve parfois, s’aveugle souvent, notamment sur la situation politique. Au travers des paroles, on entend surtout les silences que la partition de Legrand ne parvient pas à effacer. Des 50 heures d’images et d’interviews, réduites d’abord à 7 heures puis à 2, la restauration présentée par Béatrice de Pastre, directrice des collections du CNC, est encore écourtée d’une vingtaine de minutes, coupe souhaitée par le réalisateur mais présentées ici à part.
Samedi 9 avril. Drôle d’aventure que celle de ce CLEOPATRE SIEGE DE CALAIS (1910) de Zecca dont deux versions existent. Une version mexicaine découverte en 2002 et montrée en 2010, permet d’identifier dans le CLEOPATRE de Zecca plusieurs plans intrus dont trois d’une bataille aux allures médiévale tranchant dans un univers antique. Des recherches dans le journal Bulletin Hebdomadaire Pathé permettent d’identifier les plans en question appartenant au BOURGEOIS DE CALAIS d’Andréani et Creissel. Alors que l’on soupçonnait un forain mexicain d’avoir procédé au rallongement de la bande originale, force a été de reconnaître que la modification a été opérée par Pathé elle-même alors en perte de vitesse et tentant de concurrencer le CLEOPATRA italien de Guazzoni beaucoup plus spectaculaire. Exemples d’un tripatouillage rappelant les plus belles pratiques des nanars et des mutilations imposées par les producteurs aux réalisateurs mais également oeuvre exemplaire des restaurations qui sont toujours plus ou moins des odyssées et transforment les restaurateurs en Indiana Jones de la pellicule.
Après une série de courts métrages dûs à la première femme cinéaste Alice Guy dont le regard original et décalé offre une fraîcheur bienvenue (inversion des genres dans LES RESULTATS DU FEMINISME ; travestissement et critique sociale dans LA FEMME COLLANTE, maîtrise de la grammaire burlesque dans l’inénarrable COURSE A LA SAUCISSE), soirée de clôture du festival avec le spectaculaire LES TROIS LUMIERES de Lang, montré dans sa version restaurée à partir d’une copie en 35 mm noir et blanc grâce à de nombreuses institutions dont la Cinémathèque de Toulouse. Une histoire d’amour par-delà la mort est l’occasion d’un somptueux voyage dans 3 lieux exotiques que sont la Bagdad du IXè siècle, la Venise du XVIIè et la cour de l’empereur de Chine. La restauration qui permet la reconstitution des cartons et la réinterprétation des teintes perdues permet de faire pleinement justice au travail des décorateurs Walter Röhrig et Robert Herlth et met en valeur les nombreux effets dont Lang a parsemé le film. Le final, d’un romantisme sacrificiel, restera une des images les plus symboliques et les plus puissante du festival : comment ne pas voir devant ces corps amoureux tombés dans la mort et réveillés par la main même de la Mort, l’image de ces films que l’on croyait à jamais perdus mais se relevant soudain du tombeau où l’histoire et le temps les ont poussés ?
Téléchargez les anciens numéros de Sueurs Froides
Inscrivez-vous à la liste de diffusion et accédez au
téléchargement des anciens numéros de Sueurs Froides :
- Une tranche d'histoire du fanzinat français
- 36 numéros de 1994 à 2010
- Près de 1800 films critiqués
Un index est disponible pour chercher un film ou un dossier
CLIQUEZ ICI.
- Article rédigé par : Stéphane Bex
- Ses films préférés :