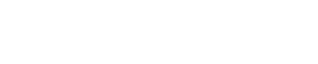LA CREATURE EST PARMI NOUS
Troisième volet consacré à la créature après le doublet de Jack Arnold, LA CREATURE EST PARMI NOUS, traduction affadie du titre original (THE CREATURE WALKS AMONG US) est l’oeuvre la moins connue de la trilogie mais non la moins intéressante. Sa resortie sous le label Elephant est l’occasion de la redécouvrir pleinement.
Ce troisième opus, placé sous la direction de John SHERWOOD, assistant réalisateur passé à la réalisation avec un western, LA PROIE DES HOMMES, et dont LA CREATURE EST PARMI NOUS constitue le second film, s’inscrit a priori dans les codes de la série B. Un faiseur honnête (Sherwood), un format court et nerveux, des aventures en terre semi-exotique, des apparitions de la créature calculées et la reprise des éléments les plus appréciés dans la saga du Gill Man. L’intrigue, comme on s’y attend, ne se présente dans un premier temps que comme une variation du second opus, à l’exception de la 3D, absente dans ce volet : ici comme là, une équipe de chercheurs et de scientifiques se lance à la poursuite du monstre ; les Everglades ont remplacé l’Amazonie dans ce troisième opus et la créature finit également enfermée mais non dans un parc aquatique. Sans surprise également, le message écologique de Jack ARNOLD (la remise en question de l’arrogance techniciste de l’Amérique des années 50 au moyen de la beauté monstrueuse d’une production de la nature) se retrouve ici aussi à l’oeuvre, transposé dans le discours éco-responsable d’un membre de l’expédition mettant en garde contre les tentations faustienne d’une science qui déséquilibrerait l’ordre naturel .
Et pourtant, LA CREATURE EST PARMI NOUS s’avère un film bien plus original que ces prémices ne le laissent paraître. Derrière la série B d’aventures inspirée de KING KONG se dissimule la possibilité d’un véritable mélo. Le chassé-croisé amoureux entre le docteur Barton (Jeff Morrow), chef de l’expédition et double du docteur Moreau, son épouse, Marcia (Leigh Snowden), le biologiste Morgan (Rex Reason), héros sans reproche et le concupiscent Grant, sert ici d’arrière-plan à la chasse et à la capture de la créature beaucoup moins attachée à la plastique féminine que dans les précédents épisodes. La violence (instinct d’agressivité et de reproduction) est ici tout entière du côté des hommes et la créature n’en constitue que le témoin silencieux comme, au final, le justicier implacable. Le remplacement de Julie Adams dans le premier opus par Leigh Snowden est l’occasion d’affiner le personnage féminin et d’en faire la figure centrale de ce film : la jeune femme, ayant épousé trop jeune un mari jaloux et violent, dessine une figure ambiguë, entre vamp légère et épouse docile. Elle incarne à la fois le refoulement d’une Amérique puritaine, dont la jouissance ne s’exprime plus que par le viol infligé aux lois naturelles, et sa possible libération. Faute de pouvoir aimer sa femme, le docteur Barton a pour projet de transformer la créature et l’adapter aux lois du monde terrestre en développant chez elles des organes encore à l’état latent, prélude à une refonte biologique de l’humain en général. Avec intelligence le scénario du film s’appuie sur une symétrie fonctionnelle : si la créature sort de l’eau, arrachée à son milieu naturel par les manipulations humaines, la contrepartie réside dans la plongée de la femme à l’intérieur de l’élément aquatique. La fameuse séquence de ballet avec Julie Adams dans le premier volet s’épanouit ici dans l’ivresse dionysiaque d’une très belle danse sous-marine. Quittant les nécessités commerciales de l’exploitation, le film encapsule en son sein un instant à la fois léger et contemplatif, véritable moment de grâce.
La créature, quant à elle, ne bénéficie pas d’un traitement aussi réussi et le film semble presque volontairement enlaidir et détruire la beauté du monstre qui caractérise les épisodes précédents. Transformée physiquement par sa mutation biologique, la créature perd son visage de poisson pour se rapprocher d’une forme à visage vaguement humain, son statut de chaînon manquant dans l’évolution étant alors souligné avec ironie. Mais ce grotesque est à mettre en parallèle avec la déconstruction opérée également du côté humain qui voit les visages lisses et harmonieux se décomposer rapidement sous l’effet des passions enfouies. Le masque grossier de la créature apparaît alors comme le miroir pathétique dans lequel devrait se plonger une humanité qui a oublié son origine. Forcée de marcher sur la terre parmi les vivants, à la façon d’un zombie, la créature antédiluvienne prend alors l’apparence d’un étrange marcheur apocalyptique venu incarner la loi d’une nature divinisée. En se mettant en abyme, le film opère ainsi en même temps sa propre critique et justification. Le sequel, exigence commerciale, conduit à la défiguration de l’original d’où il est issu. Le bref passage sur terre du Gill Man, s’il se justifie en tant que variation nécessaire, met en garde également les spectateurs, un peu à la façon déjà du second épisode, contre la dénaturation artistique, résultat de la société de spectacle. Une autre séquence, prenant au pied de la lettre, l’esprit d’économie de la série B, en joue avec un certain humour : un sonar embarqué permet à un membre de l’équipage de suivre en direct les évolutions des nageurs et l’apparition de la créature, sous forme de légers traits ondulants. L’illustration minimaliste et abstraite des hommes comme du monstre renvoie à leur insignifiance commune fondamentale. L’un et l’autre ne sont que des signaux temporaires sur un écran, celui du cinéma comme celui de l’évolution biologique, et signaux quasi indistincts : ce rappel à l’ordre du fondement spectaculaire en annule de façon ironique et critique le caractère pittoresque. On ne voit que ce qu’on imagine. Le monstre est fabriqué par notre propre regard. Il est notre vision renvoyée en miroir.