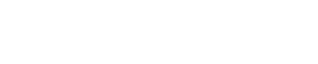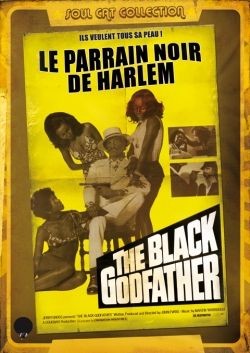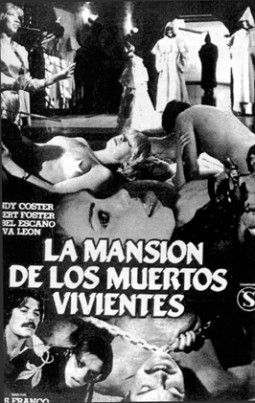La dame rouge tua sept fois
Italie - 1972 - Emilio Miraglia
Titres alternatifs : La dama rossa uccide sette volte, The red queen kills seven times
Interprètes : Barbara Bouchet, Ugo Pagliai, Sybil Danning, Marina Malfatti
Assistant-réalisateur dès le début des années 60 sur des petites productions fauchées (surtout des péplums : HERCULE CONTRE LES FILS DU SOLEIL de Osvaldo Civirani, 1964), Emilio Miraglia n’a réalisé que six films, utilisant souvent le pseudonyme de Al Brady ( !). Il doit sa petite réputation auprès des amateurs de cinéma « bis » pour les deux titres signés sous son véritable patronyme : THE NIGHT EVELYN CAME OUT OF THE GRAVE/L’APPEL DE LA CHAIR (de 1971 avec Erika Blanc) et LA DAME ROUGE TUA SEPT FOIS, deux giallos tournés en plein âge d’or du genre. Relancé à la suite du succès phénoménal de L’OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL de Dario Argento (1969), le giallo devient au tout début des années 70 un objet purement commercial et opportuniste pour certains (Umberto Lenzi et ses très médiocres PARANOIA, 1970 ou LE TUEUR A L’ORCHIDEE, 1971) mais aussi un fructueux et passionnant terrain d’expérimentation pour d’autres (LA QUEUE DU SCORPION de Sergio Martino , JE SUIS VIVANT de Aldo Lado, LA BAIE SANGLANTE de Mario Bava en 1971 ; MAIS QU’AVEZ-VOUS FAIT A SOLANGE de Massimo Dallamano, LA LONGUE NUIT DE L’EXORCISME de Lucio Fulci en 1972). Nous verrons que le film de Emilio Miraglia se situe idéalement entre ces deux « courants » (exploitation d’un filon et œuvre personnelle voire visionnaire).
Une malédiction ancestrale semble frapper les Wildenbruck : selon la légende (illustrée dans un tableau macabre), tous les cent ans, une fille de la famille (la « dame en noir ») serait poussée à tuer sa sœur (la « dame en rouge ») qui reviendrait alors sous la forme d’un fantôme pour tuer sept personnes dont sa meurtrière. Dans les années 70, Kitty Wildenbruck (Barbara Bouchet) tue accidentellement sa sœur Evelyne ; avec la complicité de sa sœur Franziska (Marina Malfatti), Kitty camoufle cette mort et fait croire à un exil d’Evelyne aux Etats-Unis. C’est alors qu’une série de crimes violents sont commis dans l’entourage de Kitty : celui de son grand-père (qui laisse un important héritage) puis de son patron, directeur de l’agence de mode dans laquelle elle travaille. Dans les deux cas, des témoins ont cru voir une mystérieuse « dame en rouge » qui rappelle bien sûr celle de la légende familiale.
De l’aveu même du réalisateur, LA DAME ROUGE TUA SEPT FOIS fut conçu sous l’influence du succès critique et artistique de la « trilogie animalière » de Dario Argento (L’OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL, 1969, LE CHAT A NEUF QUEUES, 1970, QUATRE MOUCHES DE VELOURS GRIS, 1971) qui venait de redéfinir le giallo et de l’imposer comme courant majeur du cinéma de genre italien. Le film d’Emilio Miraglia peut sembler de prime abord empiéter de manière trop visible sur l’univers « argentesque » avec son intrigue à base de trauma infantile, ses personnages douteux issus de la bourgeoisie oisive, ses meurtres stylisés, son assassin fétichiste et spectral ou son utilisation de la musique comme élément rythmique et sensoriel prépondérant. Mais à y regarder de plus près, LA DAME ROUGE TUA SEPT FOIS contient sa propre identité qu’elle puise du côté du conte gothique auquel le film emprunte structure narrative, thèmes et motifs figuratifs. De la superbe séquence d’ouverture dans la demeure baroque des Wildenbruck où les petites sœurs Kitty et Evelyne semblent envoûtées par la peinture représentant le meurtre initial jusqu’au final dans une crypte immergée envahie par les rats, en passant par les apparitions fantomatiques de la « dame rouge », tout converge dans ce sens. Respectant scrupuleusement l’esprit du conte gothique, le réalisateur s’amuse à brouiller les pistes, à insuffler des éléments fantastiques à son récit, à faire se chevaucher passé et présent, à mêler dans une même scène le rationnel et l’inexpliqué. Le film prend alors une autre dimension et fait se succéder de belles séquences oniriques (la « dame rouge » apparaissant en transparence ou se précipitant armée d’un couteau vers la caméra…) et des plans extrêmement sanglants (une victime a la gorge empalée par une grille, telle autre a le crâne explosé…). Certaines fulgurances visuelles et le basculement du film dans l’irréel semblent même préfigurer le PROFONDO ROSSO (1975) de Dario Argento ; juste retour des choses… Parallèlement à cet univers gothique qui va progressivement contaminer l’espace filmique, un autre milieu, celui de la mode où évoluent la plupart des personnages, est également dépeint. « Glamour » et fastueux en apparence (séances de photos sexy, costumes de la créatrice Mila Schön, actrices sensuelles…), ce microcosme se révèle gangrené par la cupidité de ses protagonistes, à l’instar du chef-d’œuvre de Mario Bava, SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN (1964), véritable matrice du giallo. Le film n’est pas exempt de défauts, on peut regretter quelques invraisemblances dans le scénario (notamment une scène de viol tout à fait inutile) et, comme souvent dans le genre, un final plutôt décevant. L’interprétation n’est pas des plus solides mais nous permet d’admirer les belles Barbara Bouchet (LA TARENTULE AU VENTRE NOIR de Paolo Cavara, 1971) et Sybil Danning (BARBE BLEUE de Edward Dmytryk, 1972). La musique de Bruno Nicolai qui mélange air de comptine fredonnée, morceaux entêtants au clavecin ou à l’orgue et rythmiques rock est simplement inoubliable.
Téléchargez les anciens numéros de Sueurs Froides
Inscrivez-vous à la liste de diffusion et accédez au
téléchargement des anciens numéros de Sueurs Froides :
- Une tranche d'histoire du fanzinat français
- 36 numéros de 1994 à 2010
- Près de 1800 films critiqués
Un index est disponible pour chercher un film ou un dossier
CLIQUEZ ICI.
- Article rédigé par : Alexandre Lecouffe
- Ses films préférés :