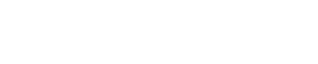Les salauds dorment en paix
Carlotta poursuit sa réédition de l’oeuvre kurosawienne durant les années Toho, le grand studio japonais, avec trois chefs d’oeuvre qui partagent un même acteur (Toshirô Mifune) et une noirceur déclinée selon trois variations. Etendons donc encore plus l’éventail de ces redécouvertes présentées ici dans une luxueuse version assortie de livrets bien fournis.
Si les BAS FONDS n’a pas entièrement convaincu la critique, lui reprochant notamment le jeu hyperbolique des acteurs et la radicalité du dispositif, il n’en est pas de même avec LES SALAUDS DORMENT EN PAIX sorti en 1960, après LE CHATEAU DE L’ARAIGNEE (1957) et LA FORTERESSE CACHEE (1958), les trois formant une sorte de trilogie inspirée par la matière shakespearienne. Avec LES SALAUDS DORMENT EN PAIX, Kurosawa livre un film noir à la japonaise – avec toutes les réserves que cela comporte vis-à-vis de la définition du genre -. Le film met en scène une vengeance ourdie pendant plusieurs années contre des fonctionnaires corrompus et responsables de la mort d’un bouc émissaire s’étant défenestré d’un immeuble dont la construction a été permise par des pots-de-vin. Débutant par une scène de mariage mémorable et qui influencera LE PARRAIN de Coppola, le film déroule les anneaux successifs de cette vengeance se resserrant inéluctablement autour du principal responsable.
Mais l’habileté du film dans la conduite de son récit ne l’empêche pas non plus de se faire le support d’une interrogation morale qui touche le héros, Nishi, principal instigateur de la vengeance : au nom de la justice, doit-il se rendre aussi cruel que les gens qu’il condamne et ainsi sacrifier Yoshiko qu’il vient d’épouser ? Kurosawa double ainsi ce film relevant de ce qu’on pourrait appeler le MURDER AND REVENGE, d’un drame amoureux et moral très réussi dans lequel Mifune excelle par sa retenue et ses élans soudains. Ce double régime filmique se retrouve encore dans le double traitement des décors et l’esthétique choisie : longues focales et expressionnisme renforcé des contrastes pour les scènes extérieures, accentuant la solitude et l’angoisse des personnages au sein de rues désertes et nocturnes ; plans moyens inversement et lumière unie et crue pour les scènes d’intérieur dans lesquelles les personnages tombent le masque en révélant combien ils sont gagnés par le mal. L’abstraction des lignes dans le découpage urbain et architectural comme dans la structuration des intérieurs trouve ainsi son versant fantastique avec le jeu des ombres et lumière tout autant que son versant lyrique avec le jeu des écrans et des Shoji, ces parois coulissantes dans les intérieurs japonais. Dans une très belle scène, le désespoir de Yoshiko, rejetée par Nishi est ainsi exprimé par une voix off émanée de derrière une paroi qui s’est refermée comme si les murs parlaient d’eux-mêmes, imprégnés de la douleur silencieuse de ceux qui les habitent.
Ce double régime trouve d’ailleurs son expression symbolique dans le handicap qui touche la même Yoshiko qui boîte à la suite d’un accident et se rend à son mariage avec une chaussure plus haute que l’autre. Ce qui au théâtre marquerait une opposition entre style noble de la tragédie (le cothurne élevé) et style bas de la comédie (la crépide ou le soccus), sert à exprimer ici le malaise créé par un effet de redoublement sans similitude qui devient un leitmotiv du film de Kurosawa. On trouve ainsi deux Nishi ; certains personnages trouvent la mort deux fois et deux amis-ennemis entourent Nishi, symétriques l’un par rapport à l’autre. Seule Yoshiko – c’est la force du personnage – apparaît isolée, seul personnage féminin dans un monde exclusivement masculin, femme fatale malgré elle et sacrifiée pour que l’injustice ne soit pas découverte.
Ce redoublement est aussi celui que l’on trouve dans HAMLET, le chef d’oeuvre shakespearien dont Kurosawa s’est inspiré pour traduire les états d’âme et les hésitations de son héros. La vengeance doit-elle être menée à son terme, et ce pour un père qui n’a même pas reconnu dans le passé celui qui cherche à lui rendre justice ? De même qu’Hamlet met en scène le spectacle de la trahison et la mort du père, de même Nishi se fait-il le metteur en scène de sa vengeance, construisant des fictions et des scénarios pièges pour ses adversaires, parmi lesquels on retient un enterrement truqué très réussi. Derrière le drame social et le réalisme du film noir se dissimule encore l’idée que le monde n’est qu’un grand plateau où tout le monde joue un rôle, renvoyant à la conception shakespearienne du monde comme théâtre.
D’un côté la scène, de l’autre l’écran, surface sur laquelle on projette autant qu’elle dissimule, comme font écran les mensonges des fonctionnaires corrompus donnant le change jusqu’à leurs proches. Traverser cet écran et révéler le mensonge est un acte de vérité et de vérité cinématographique. Dans la fiction, père et fils paient ainsi de leur vie la volonté de mettre le mal au grand jour et cette mort s’effectuera en traversant pour l’un et pour l’autre deux écrans symboliques et y disparaissant. De son côté, le réalisateur aura réalisé le constat réaliste et désabusé d’un Japon continuant à porter le mal de sa défaite et des affaires scandaleuses de l’après-guerre. Décidément, comme dans le royaume de Danemark, il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Japon dit Kurosawa.