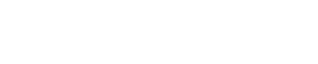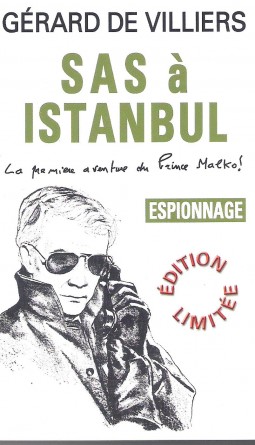Leslie, my name is evil
La saga meurtrière de la famille Manson est source d’inspiration cinématographique : John Aes-Nihil en tire, en 1984, un film lorgnant du côté expérimental avec MANSON FAMILY MOVIES et plus récemment le MANSON FAMILY de Jim Van Bebber (2003) amenant l’épopée sanglante du côté du slasher et de la reconstitution historique. Plus récemment encore, l’intérêt, se déplaçant du gourou diabolique vers ses sectateurs, a mis en lumière le rôle des trois jeunes femmes ayant participé au meurtre des LaBianca : en font preuve THE MANSON GIRLS de Matthew Bright et THE FAMILY de Scott Kosar, projets qui semblent malheureusement enterrés pour l’instant.
C’est l’angle que choisit Reginald Harkema, connu pour son travail de monteur et qui signe avec LESLIE, MY NAME IS EVIL sa quatrième œuvre de fiction, pour évoquer ce qui reste considéré comme le premier cult killing de l’histoire américaine. Le film suit ainsi le trajet de la jeune Leslie Van Houten, homecoming princess, qui la conduit d’une famille suburbaine jusque dans le cercle intime du célèbre tueur. Lui est opposé le destin du jeune Perry, jeune homme wasp et étudiant en chimie, qui est choisi comme membre du jury chargé de statuer sur le sort des membres de la famille après leur arrestation.
Harkema offre ainsi la vision de deux Amériques diamétralement opposées : celle marquée par l’idéal de bonheur d’une culture normée et celle de la contre-culture hippie sur fond de guerre du Vietnam et de manifestations. Le film épouse la transformation progressive de Leslie en même temps qu’il révèle, à travers Perry et la fascination qu’il entretient pour Leslie, l’arrière-plan de frustration sexuelle qui est celle de la classe à laquelle il appartient.
Ce qui aurait pu devenir une confrontation simpliste entre valeurs d’un fondamentalisme chrétien et monde des sixties à base de drogues, sexe et rock’n roll façon Woodstock, s’enrichit alors subrepticement de la rencontre entre les deux personnages principaux, travaillés par les doutes et les ambiguïtés. Perry, attiré au fur et à mesure du procès par l’esprit contestataire qui souffle sur la « famille », remet en cause son futur mariage et son engagement patriotique. Leslie, dévouée à son mentor, n’est pas pour autant seulement une sectatrice aveugle et Kristen Hager offre dans la partition de son jeu, si l’on excepte les minauderies empruntées à la Juliette Lewis de KALIFORNIA, une certaine finesse permettant d’entrevoir les failles du personnage. La romance esquissée, limitée par les nécessités du réalisme historique, laisse alors ouvert un passage à d’autres devenirs laissés à l’imagination du spectateur.
Cette volonté de malmener le carcan historique est sans doute la grande liberté et l’intelligence du film d’Harkema qui ne se laisse pas prendre au piège de la reconstitution fidèle ; le monde de Perry, soutenu par une imagerie empruntée à MAD MEN ou PLEASANTVILLE (film dont le héros Tobey Maguire semble avoir servi de modèle dans le jeu lisse et volontairement maladroit de Gregory Smith qui incarne Perry) est un composé indigeste des clichés fifties et sixties poussés jusqu’au grotesque. Raide et compassé, Perry s’engonce dans des décors symétriques et étouffants. Là où les vies restent guidées par la bible des valeurs familiales, aucun échappatoire ne semble possible et l’idéal du bonheur se teinte selon les couleurs chromos des cartes postales, à l’image de ce coucher de soleil sur la mer contemplé par les deux tourtereaux assis sur leurs sièges de voiture et respectant entre eux la distance qui sauvegarde la virginité de leur corps. Harkema se fait alors féroce dans la satire (l’affiche reprenant le motif du BOB ROBERTS, le film satirico-politique de Tim Robbins en est déjà une preuve) mais, s’il force le trait, ce n’est pas forcément aux dépens des personnages. On peut ainsi saluer la performance de Kristin Adams, dans le personnage de Dorothy, la fiancée bon teint du héros : sous ses allures de promo queen superficielle perce parfois une douleur plus profonde lorsqu’elle sent l’éloignement de Perry, le personnage rappellant alors celui d’Alma, l’épouse délaissée incarnée par Michelle Williams dans LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAINS d’Ang Lee.
Á l’artificialité de ce monde, Harkema oppose celui des actualités délivrant brutalement et sobrement des images de guerre ou de manifestations en noir et blanc ne faisant l’objet d’aucune reconstitution. Si le discours sous-jacent au film en fait, presque d’une manière obligée, une chambre de résonance pour la violence des meurtres, leur intérêt principal réside cependant dans leur intégration directe à l’intérieur du film. En effet, Harkema choisit la solution la moins conventionnelle mais la plus économique et la plus judicieuse pour ces images en abandonnant la dimension de commentaire, qui est le plus souvent leur rôle, pour les faire participer telles quelles au récit. Elles sont ainsi le contre-champ du monde de Perry, protégé derrière des murs ou des vitres, assistant au spectacle de la violence déployée dans les rues ou sur les champs de bataille. La séparation des régimes esthétiques (noir et blanc pour les actualités, couleurs saturées pour le monde de Perry) accentue dès lors le rapport inconciliable entre ces deux univers, montrant l’incapacité de Perry à saisir les évolutions et les mutations qui s’opèrent et l’enfermant de plus en plus à l’intérieur de sa bulle asphyxiante. Á l’image de cette scène dans laquelle Perry, spectateur d’une manifestation étudiante alors qu’il se trouve dans son laboratoire en train de manier une potion d’un rose éclatant, laisse s’écouler le liquide au sol comme un nouveau Docteur Jerry qui n’aurait pas saisi la chance de devenir Mister Love.
Certes, tout n’est pas réussi dans LESLIE, MY NAME IS EVIL et la construction dramatique apparaît bancale. Efficace dans sa première partie et sa description de Manson comme gourou illuminé mais n’ayant pas encore infléchi son discours, le film peine à transcrire ce revirement, expédié en une scène, pour se diriger vers le grand morceau du procès où le grotesque devient parfois un peu tapageur. Néanmoins, son inventivité formelle le place largement au-dessus des biopics habituels et sa retenue autant qu’un certain sens de l’absurde dans les scènes de massacre lui permettent d’échapper à la contrainte du genre. Harkema livre une œuvre intrigante et qui mérite beaucoup plus que l’oubli dans lequel on la maintient.
Joyeux dans sa forme mais pessimiste dans son fond, le film d’Harkema se présente finalement comme un constat désabusé sur l’Amérique des années 60 décrite comme une société de spectacle mortifère. Que ce soit avec les démonstrations théâtrales et outrancières de la famille Manson au cours du procès ou les rêves frelatés d’une psyché collective, Harkema nous fait assister à la mise en place d’une modernité dont nous sommes encore les héritiers. Renvoyant dos à dos l’hypocrisie d’une Amérique pourvoyeuse de crimes mais se donnant bonne conscience et la monstruosité de ceux dont elle fait ses boucs émissaires, il montre comment discours démocratique et charité religieuse inversent leurs dires pour devenir l’un et l’autre des pourvoyeurs de haine et de mort. Le film ressemble à son image finale (que l’on ne révélera pas) faussement démagogique dans son installation, elle infléchit le pathétique dans une direction inattendue, ne force pas le spectateur à détourner les yeux mais le fait elle-même, indiquant la direction d’une marge dont Harkema semble avoir fait son terrain d’élection. Le métrage, dès lors, pourrait trouver sa place à côté du ZODIAC de Fincher, tourné un an avant mais évoquant la même période. Á la différence près que le couple assassiné dans le film de Fincher se retrouve ici grand vainqueur de l’histoire, ayant su enterrer les démons qui étaient aussi la condition d’une nouvelle prise de conscience, laquelle n’aura pas lieu.