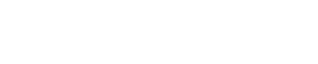Paperhouse
En dépit d’une filmographie plutôt conséquente comptant une quinzaine de titres pour le cinéma, le réalisateur britannique Bernard Rose demeure plutôt méconnu et ce bien qu’il ait signé des œuvres « grand public » aux budgets confortables (LUDWIG VAN B., 1994 ; ANNA KARENINE avec Sophie Marceau, 1997…) ainsi qu’un des rares chefs d’œuvre du cinéma fantastique des années 90, CANDYMAN (1992). Peut être trop éclectique dans ses choix et trop irrégulier dans ses réussites, Bernard Rose n’a jamais vraiment été salué comme un auteur ni reconnu comme un bon artisan du cinéma de genre. Inclassable, méconnu, deux adjectifs qui siéent également au troisième long-métrage du réalisateur, PAPERHOUSE. Celui-ci est l’adaptation assez libre d’un roman pour enfants de Catherine Storr, « Marianne dreams », déjà adapté sous forme de mini-série pour la télévision britannique dans les années 70. Ce nouveau projet de transposition se veut alors beaucoup plus moderne et sophistiqué, porté par un réalisateur « visuel » (il est un talentueux « clippeur ») et une directrice artistique, Anne Tilby, ayant œuvré avec le baroque et délirant Ken Russell (sur GOTHIC, 1986 et LE REPAIRE DU VER BLANC, 1988). Tourné à une époque où le cinéma anglais, sous perfusion, propose surtout du « réalisme social » (Ken Loach, Mike Leigh, Stephen Frears…), PAPERHOUSE ne parviendra pas à trouver son public et, en dehors de quelques festivals spécialisés (celui d’Avoriaz notamment où il recevra le Grand Prix de l’Etrange), ne connaîtra pas d’exploitation en salles. Tombé progressivement dans l’oubli, le film a cependant un noyau dur d’ardents défenseurs qui continuent de saluer, vingt-cinq ans après sa conception, sa profonde singularité.
Anna, onze ans, est une petite fille mal dans sa peau, inadaptée au système scolaire, en conflit avec sa mère et souffrant des absences prolongées de son père. Alitée à la suite de deux pertes de connaissance inexpliquées, Anna se rend compte qu’elle peut modifier le cadre et le cours des ses rêves : ce qu’elle dessine ou efface lorsqu’elle est éveillée apparaît ou disparaît ensuite dans ses songes ! C’est ainsi qu’après l’avoir représenté à la fenêtre d’une étrange maison isolée, elle fait la connaissance en rêve de Marc, un garçon invalide de son âge. Bientôt, Anna se persuade qu’elle peut guérir son nouveau compagnon et que ce dernier ne fait qu’un avec le garçon handicapé et gravement malade dont lui a parlé le médecin qui la soigne…
Le film débute, de façon assez classique, par ce qui ressemble à une chronique réaliste de l’enfance et de son mal être à travers le personnage d’Anna, préadolescente dont le caractère hautain semble cacher un manque affectif. En quelques séquences qui synthétisent toutes les facettes de son existence (l’école, la gare désaffectée où elle joue, le cadre urbain où elle vit, le « cocon » de sa chambre), le réalisateur parvient à donner corps à son héroïne et à son angoisse encore diffuse. Autant dire que le surgissement de l’étrange et du fantastique très tôt dans ce récit d’un quotidien banal, au travers de la figuration et de la matérialisation du premier rêve Anna, peut paraître déstabilisant. Il est en effet assez rare au cinéma que l’univers onirique, et à fortiori celui d’un enfant, devienne dès le départ le matériau premier de la fiction et dirige ensuite les circonvolutions de celle-ci. Si l’on pense lointainement au fameux LE MAGICIEN D’OZ (Victor Fleming, 1939) ou au subtil LES 5000 DOIGTS DU DR.T (Roy Rowland, 1952), PAPERHOUSE s’en éloigne résolument par sa tonalité bien plus grave et par le fait qu’il entremêle de manière complexe rêve et réalité. Le film construit peu à peu son identité en puisant dans « l’inquiétante étrangeté » et en infusant son récit d’éléments-clés issus du conte de fées et de la psychanalyse pour évoquer des thèmes liés à l’enfance et à ses peurs larvées. La démarche de Bernard Rose rejoint ici celle de son compatriote Neil Jordan qui dans son très beau LA COMPAGNIE DES LOUPS (1984) s’intéressait aussi aux troubles infantiles et convoquait, de façon remarquable, théories freudiennes et relectures du « Petit chaperon rouge ».
PAPERHOUSE tire quant à lui une part essentielle de sa réussite de la beauté plastique qui émane de ses séquences oniriques ; à l’aide de trucages visuels simples (fausses perspectives, maquettes, matte-paintings…), le réalisateur confère à cette représentation de l’imaginaire d’Anna la texture à la fois naïve, abstraite et insaisissable des rêves. On pourra en effet sourire de la simplicité des décors créés par la jeune héroïne (un champ de blé à perte de vue, une petite maison isolée, quelques rochers, un arbre…) mais y voir aussi la discrète dimension symbolique que revêt la plupart des objets et formes de ce micro-univers mental. Celui-ci se caractérise d’ailleurs par sa tonalité mélancolique, à l’image du personnage de Marc, atteint d’hémiplégie, et par l’atmosphère progressivement anxiogène qui viendra menacer physiquement les deux enfants. Car PAPERHOUSE utilise, de façon pas forcément très convaincante, la figure archétypale du « boogeyman » (ou de l’ogre, pour rester dans le domaine du conte) dont on taira l’identité et qui permet surtout à Bernard Rose de rendre un hommage appuyé à LA NUIT DU CHASSEUR (Charles Laughton, 1954), une source d’inspiration qu’il revendique ouvertement.
Si le film s’égare un peu lorsqu’il essaie de s’engager sur les chemins ultra-codifiés de l’épouvante, il se singularise en revanche en esquissant en creux une réflexion sur la création artistique et plus particulièrement sur tout ce qui a trait au pictural. On peut en effet voir dans la matérialisation des dessins d’Anna et dans l’influence que ceux-ci auront sur le cours de sa vie réelle l’illustration de l’idée selon laquelle l’art (aussi naïf soit-il) doit être perçu comme sublimation des pulsions. C’est en donnant corps à son inconscient le plus profond que la -pas encore- jeune fille parviendra à atteindre un stade supérieur de sa conscience, qu’elle passera de l’état d’enfant à celui d’adolescente et qu’elle abandonnera une part de ses peurs et désirs refoulés.
Si PAPERHOUSE invite à une lecture psychanalytique de son sujet, il le fait de manière assez délicate en privilégiant une atmosphère poétique où la magie semble exister et où l’imaginaire l’emporte toujours sur le réel. Malgré certains défauts de construction et quelques plans trop marqués par l’esthétique « bleutée » des années 80, PAPERHOUSE est un exemple assez unique de film fantastique s’adressant aux adultes et aux enfants. L’œuvre de Bernard Rose a de toute évidence semé des graines chez plusieurs réalisateurs ayant traité par la suite du thème de l’enfance douloureuse dans le cinéma fantastique et plus certainement chez le très talentueux Guillermo del Toro (LE LABYRINTHE DE PAN, 2006).