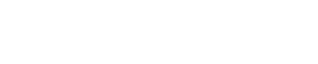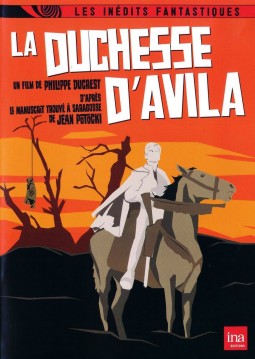Schizophrenia
Autriche, début des années 80. Après avoir purgé une peine de dix ans derrière les barreaux pour avoir tenté d’assassiner sa mère puis pour avoir tué une vieille dame, un homme est libéré, bien décidé à commettre de nouveaux crimes. Après avoir vaguement tenté d’approcher deux jeunes filles dans un bar, l’individu monte à bord d’un taxi conduit par une femme. Cette dernière lui rappelle celle qu’il connut à l’adolescence et avec qui il avait eu une relation sadomasochiste. Il tente alors d’étrangler la conductrice avec son lacet, échoue et s’enfuit dans la forêt avoisinante ; il se réfugie dans une grande maison assez isolée qu’il pense abandonnée. Elle est en fait habitée par trois personnes : une vieille dame, son fils handicapé et une jeune femme ; le tueur jubile et s’apprête à passer à l’acte.
Indépendant, expérimental, extrême, culte : voici quelques adjectifs qui définissent parfaitement SCHIZOPHRENIA (ANGST, « peur » en v.o.). Le film a été auto-produit par son réalisateur Gerard Kargl dont ce fut la seule incursion au cinéma, son enfant unique l’ayant tellement endetté qu’il fut obligé ensuite de se tourner vers des projets « alimentaires » pour la télévision allemande. La distribution du film fut des plus limitée : classé X ou sans visa dans la plupart des pays, il ne fut quasiment projeté qu’en festivals durant une quinzaine d’années durant lesquelles sa rareté et sa radicalité en firent une œuvre culte. Une grande partie de la réussite conceptuelle de SCHIZOPHRENIA provient de toute évidence du rôle essentiel joué par le chef-opérateur Zbigniew Rybczynski qui fut également co-scénariste et monteur sur le film. Cet artiste avant-gardiste polonais qui travailla dans l’animation (il reçut un Oscar en 1980), dans la réalisation de clips (« Imagine » de John Lennon) puis dans la technologie numérique alors naissante, peut même être considéré comme le co-auteur de ce long métrage unique à plus d’un titre.
Prenant comme point de départ narratif un fait divers meurtrier ayant eu lieu en Autriche en 1980, SCHIZOPHRENIA semble s’inscrire dès ses séquences d’ouverture dans une veine plus expressionniste que réaliste, filmant l’extérieur puis l’intérieur d’une prison déserte et silencieuse non comme un lieu réel mais comme un espace mental recréé par le personnage-narrateur dont la voix off explique brièvement le passé meurtrier ; le « ploc » régulier et amplifié d’une goutte d’eau dans la bande son renforce l’idée que nous sommes à l’intérieur d’un esprit dérangé. Si le cinéma de genre a parfois proposé d’épouser le point de vue d’un être malade et dangereux (le final de PSYCHOSE de Alfred Hitchcock, 1960 ; MANIAC de William Lustig, 1980…), SCHIZOPHRENIA le fait de façon si abrupte et lancinante que le spectateur se retrouve dans une sorte d’immersion forcée où se mêlent fascination et répulsion. Ces deux sentiments contradictoires sont tout d’abord rendus possibles par le charisme naturel et la complexité qui se dégagent de la personnalité et du physique de l’acteur principal, Erwin Leder, qui rappelle un peu l’américain Brad Dourif, grand spécialiste des rôles d’azimutés. Mais c’est très certainement par sa mise en scène virtuose que le film impressionne surtout : l’extrême mobilité de la caméra, les tours de force techniques de certains mouvements d’appareil et plusieurs plans visuellement inédits achèvent de faire de SCHIZOPHRENIA une expérience fascinante. La mise en images oscille en effet entre deux partis-pris à la fois opposés et complémentaires : une vision subjective épousant les méandres malsains de la psyché du tueur et une figuration plus en retrait des différents événements. La proximité presque hypnotique entre le protagoniste et le spectateur se fait par le biais d’une voix off quasi permanente évoquant ses traumas et affects morbides, par la récurrence de très gros plans du visage du psychopathe mais surtout par l’utilisation de la Snorricam dans de nombreuses séquences. Cette caméra, fixée sur un harnais, fait face à l’acteur qui paraît alors immobile lorsqu’il se déplace tandis que le cadre autour de lui semble en ébullition ; outre la force visuelle qui s’en dégage, ces plans fulgurants traduisent parfaitement la perception chaotique et déformée que le tueur a du monde qui l’entoure.
Mais si les deux auteurs de SCHIZOPHRENIA avaient pour but de nous placer au plus près de l’esprit d’un être dérangé, ils savaient également que le recours à cette forme de focalisation interne un peu brutale et hyperréaliste aurait conduit, sur une durée trop longue, à une « asphyxie » du spectateur et plus particulièrement dans l’acte central du film qui se déroule dans un lieu clos, sinistre et étouffant, la demeure bourgeoise et décrépite où l’assassin s’est réfugié (et que l’on peut à nouveau interpréter comme un lieu symbolique et abstrait, un espace mental reconstruit par notre antihéros…). Si plusieurs séquences filmées au Steadicam ou à la grue permettaient déjà d’avoir une vision plus distante voire « aérienne » des actes du schizophrène, la multiplication des plans larges, des cadrages en plongée et l’importance du hors champ offrent un salutaire point de vue externe sans lequel le film serait certainement insoutenable. Précisons cependant que SCHIZOPHRENIA contient bien évidemment plusieurs passages très graphiques mettant en scène, entre autres, des actes de nécrophilie et de cannibalisme. Si les auteurs ont su éviter la surenchère et la gratuité lors des scènes « difficiles », inutile de préciser que le long métrage s’adresse tout de même à un public averti qui aura fait le choix de vivre une expérience sensorielle à la fois dérangeante et envoûtante.
SCHIZOPHRENIA demeure, près de trente ans après sa réalisation, un objet filmique d’une radicalité et d’une virtuosité sidérantes ; outre l’œuvre de Gaspard Noé (SEUL CONTRE TOUS, 1998) qui en est ouvertement imprégnée, on peut penser que le film aura directement influencé des titres aussi divers que C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS (Rémy Belvaux ,1992), SCHRAMM (Jorg Buttgereit, 1994), FUNNY GAMES (Michael Haneke, 1997) ou SOMBRE (Philippe Grandrieux, 1998).