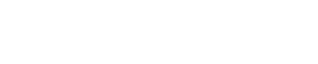The act of killing
Lors de la première vision du film de Joshua Oppenheimer, au travers des deux scènes d’ouverture dignes d ‘un Jodorowsky, où pour la première une file de danseuses asiatiques sort de la bouche d’un énorme poisson-maison, dans un paysage au ciel teinté de rose, une question voit le jour immédiatement : Où sommes nous ?… Question qui ne se pose pas tant à propos d’une situation géographique, qu’en terme de forme cinématographique. Question que le spectateur sera également amené à se poser à plusieurs reprises au long des 158 minutes de la version intégrale de ce documentaire hors-normes.
Le texte mis en exergue nous informe du fait qu’en 1965, en Indonésie, la junte militaire ayant pris le pouvoir, aidée par des gangsters et une organisation paramilitaire, est à l’origine de l’exécution de plus d’un million de communistes ou désignés comme tels. Les auteurs du massacre sont toujours au pouvoir à l’heure actuelle, ou à des postes-clé, continuant à persécuter leurs opposants.
Le postulat de départ de Joshua Oppenheimer était de réaliser un document autour des témoignages des survivants de ces exactions. Face à leurs réticences, il se rendit compte qu’en fait ceux-ci avaient encore comme voisins leurs anciens persécuteurs qui, loin de se cacher, paradaient toujours persuadés de la justesse et du bienfondé de leurs actes.
Oppenheimer changea alors son fusil d’épaule en proposant à ces derniers de relater leurs agissements devant sa caméra – ce que certains s ’empressèrent de faire – voire même de se mettre en scène et de réaliser avec son aide un film de fiction témoignant de leur « glorieux » passé…
D’emblée le réalisateur nous confronte à Anwar Congo et à Herman Koto, deux personnages se revendiquant fièrement en tant que gangsters ayant activement participé aux persécutions de 1965/66. On les voit dans la rue, en pleine séance de « casting » afin de recruter auprès de la population des figurants dans l’idée de recréer une scène de saccage de maisons. Reconstitution mise en scène par Herman Koto lui même, s’occupant de la direction d’acteurs et du jeu de ses figurants, et qui sera également en partie retranscrite par la caméra d’Oppenheimer, totalement immergée au cœur de l’action.
Cette séquence à elle seule suffit à nous camper la personnalité de ceux qui vont devenir les témoins et les interlocuteurs privilégiés de Joshua Oppenheimer. Autant Herman Koto apparaît comme une brute épaisse, bouffie de fatuité et de suffisance, autant de prime abord Anwar Congo semble sur la réserve face à la caméra, se tenant en retrait de l’agitation, en apparence plus froid et calculateur.
Le même Congo ne rechigne cependant pas, peu après, à évoquer l’inventivité dont il a pu faire preuve par le passé en matière de mise à mort des opposants, non dans l’idée d’alléger leurs souffrances, mais uniquement dans celle d’éviter l’odeur pestilentielle liée au départ à des méthodes bien trop sanglantes.
La galerie de personnages que nous découvrons au long du métrage n’a par ailleurs rien à envier à ces deux-là. Membres du gouvernement, patron de presse, dirigeants d’organisations paramilitaires et autres anciens gangsters semblent se disputer la palme de l’abjection sous l’oeil d’une caméra qu’ils pensent bienveillante. Véritable défilé de parvenus incultes et satisfaits, attirés par le pouvoir, l’enrichissement personnel et le bling-bling, jusqu’à en atteindre une effrayante et écoeurante vulgarité, fièrement affichée. « Nous sommes relax et Rolex » comme le clame sur un terrain de golf, en guise de devise, le chef des Jeunesses Pancasila, mouvement paramilitaire comptant près de trois millions de membres dans la population, et qui ressemble à s’y méprendre à une SA en uniformes au camouflage orange. Ce même chef, au passage, ne manque pas de nous gratifier de sa définition – partagée par ses nombreux « confrères » – du mot gangster : Un homme libre. Libre d’entreprendre, de s’enrichir en éliminant au besoin tout obstacle qui pourrait se dresser contre lui… Alors pourquoi pas plus d’un million d’obstacles ?
Pour le reste, le film de Joshua Oppenheimer s’articule autour d’une alternance entre des séquences de dialogues ou monologues des protagonistes, visant à justifier leurs actes et leur nécessité face à l’Histoire, des séquences de ce qui semble être un making-of de la fiction induite par Oppenheimer au départ (qui aurait dû s’appeler BORN FREE…), et enfin des séquences à visée plus documentaire apportant un éclairage supplémentaire sur le contexte politique Indonésien, sur la vie et la personnalité des différents personnages impliqués.
Les premières laissent notamment nos gangsters s’épancher sur le fait que l’histoire est écrite par les vainqueurs et qu’en tant que vainqueurs ils n’ont à rougir de rien – ils ont « fait le job » car il fallait bien le faire – l’un d’entre eux allant jusqu’à pérorer sur l’hypothèse que s’il était un jour traduit devant un tribunal international, il pourrait se considérer comme une star et s’y présenter la conscience tranquille…
Les justifications d’Anwar Congo et Herman Koto ont parfois de quoi laisser pantois, quant à elles, tant elles peuvent apparaître terre à terre et éloignées de toute réelle implication idéologique. En 1965 ils étaient en charge de la vente ou revente de billets de cinéma et étant donné que les films américains dont ils étaient de grands amateurs leur assuraient des revenus et une vie confortables, l’arrivée de communistes ouvertement hostiles à ce cinéma ne pouvait en toute logique qu’entraîner une réaction radicale. Propos goguenards et décomplexés que nous livrent les deux affreux, allant jusqu’à esquisser de petits pas de danse dans la rue, en se remémorant devant leurs anciens bureaux cette époque cool où ils tuaient « dans l’allégresse », à l’image des gangsters de fiction des films qu’ils affectionnaient tant.
En ce qui concerne les séquences de making-of, on monte souvent d’un degré dans l’effarement. Outre le fait que l’on voit à plusieurs reprises les comparses discuter de choix et de points de vue, tant idéologiques que formels, en vue d’une réalisation qui nous apparaît alors comme collégiale, on assiste également à de véritables moments en roue libre. Comme dans les scènes surréalistes et hystériques (ce qui nous éclaire pour le coup sur la scène d’ouverture) où Herman koto pose en drag-queen dément et sanguinaire, ou encore celle où Anwar Congo, lors d’une reconstitution d’interrogatoire, mime sur une peluche la découpe au couteau d’un enfant qu’il commente sous les yeux de sa mère, jouée par Koto. On atteint là une terreur et un malaise que bon nombre de réalisateurs de films d’horreur peinent parfois à insuffler à leurs réalisations. C’est au travers de ces séquences également que ressurgit le rapport que ces gens entretenaient et entretiennent toujours avec le cinéma commercial, aboutissant à un feed-back entre réel et fiction qui peut s’avérer des plus dérangeants pour le spectateur. Ce qu’illustre parfaitement la scène où Congo affirme à un figurant qu’il s’apprête à torturer : «Tu es jaloux… On veut pas être pauvres. Même si on n’est que des gangsters de cinéma. On veut se sentir comme ceux qu’on voit dans les films ». On est alors en position de se demander s’il joue simplement pour se mettre en valeur, déguisé en gangster de série B, ou s’il ne fait finalement que rejouer ce qui a réellement été…
Quant aux séquences documentaires, elles complètent et éclairent parfaitement les précédentes. Depuis les meetings des jeunesses Pancasila, en passant par la promotion du futur « BORN FREE » que Congo assure à la télévision Indonésienne devant un public composé uniquement de paramilitaires en uniforme et prompts à applaudir à la moindre de ses boutades, jusqu’à la candidature de Herman Koto à des élections locales. Oppenheimer le montre d’ailleurs de manière assez implacable lors de sa campagne électorale, notamment tel un bouffon pathétique, le regard habité, en train de singer devant son miroir un discours de Barak Obama diffusé à la télévision. Mais si l’on doit n’en retenir qu’une, en tant qu’elle s’avère terriblement emblématique de la situation politique Indonésienne et de sa corruption omniprésente, c’est bien celle où des membre de Pancasila se livrent à une séance de racket de commerçants Chinois dans un marché, dans le but de financer un de leurs meetings. Alors que les paramilitaires adoptent complaisamment un ton et des attitudes propres à des personnages de films de mafia, tels que nous avons pu en voir tant, la caméra du réalisateur saisit le regard atterré et proprement effrayé des commerçants, comme si elle avait encore besoin de nous rappeler que tout ceci est bien réel… Lors d’interviews, Joshua Oppenheimer affirme d’ailleurs avoir ressenti un tel malaise lors de ce tournage qu’il retourna dédommager personnellement les commerçants.
Au final, se produira ce qu’Oppenheimer n’attendait probablement pas. Une prise de conscience de la part d’Anwar Congo de l’abomination de ses actes passés face à la caméra, et suite à certaines reconstitutions qui se sont avérées éprouvantes pour lui, le projetant à la place de ses victimes, le soumettant à l’émergence d ‘une empathie « rétroactive ». Prise de conscience dont on est en droit de se poser la question de la véracité, mais qui se manifeste devant l’objectif non seulement en prenant corps dans le discours de l’intéressé, mais également dans des manifestations physiques de nausée et de hauts-le-coeur qu’il ne parvient désormais plus à réprimer. Ce qui fait d’ailleurs écho aux nombreux cauchemars auxquels Congo fait allusion durant le film… Oppenheimer affirme dans bon nombre d’interviews que tout cela lui était apparu comme foncièrement sincère dans l’instant.
Ce qui fait la singularité de ce documentaire, ce n’est bien entendu pas le fait d’avoir donné la parole à d’ex-tortionnaires ou des instigateurs de massacres. D’autres l’ont déjà fait avant. Il suffit de citer des documents comme le livre LES ENTRETIENS DE NUREMBERG du Dr Léon Goldensohn, ou encore les films de Rithy Panh à propos du génocide Cambodgien, entre autres. Mais là où ces derniers nous exposent des personnages en position d’être jugés et condamnés pour leurs actes, pressés de se dédouaner quand ils ne se posent pas eux-mêmes en victimes d’un système, c’est bien la première fois que nous sommes confrontés de manière systématique à une galerie aussi exhaustive de salauds triomphants. Imbus d’eux-même et ne semblant absolument pas enclins à esquisser le moindre remord. Absence de remords qui certes pouvait déjà apparaître dans certains documentaires, mais avant tout de la part de gens ayant perdu leur « combat » et surtout de manière beaucoup plus fragmentaire. Nous sommes dans THE ACT OF KILLING en présence d’un florilège d’un tout autre ordre.
Le fait d’avoir proposé à ces bourreaux de s’exprimer et de s’exposer par le biais d’une fiction et d’y être parvenu, pour en arriver au résultat que nous pouvons visionner est en soi un tour de force, mais peut être aussi un jeu dangereux quand on est réalisateur, surtout lorsque l’on considère le climat politique en Indonésie…
Héritier en partie de Jean Rouch (chantre du cinéma direct ou cinéma vérité en France), Joshua Oppenheimer tire ici pleinement partie du fait énoncé par ce dernier considérant que « des personnages réels se construisent eux-mêmes cinématographiquement, en cours de film », sachant exploiter la présence de la caméra et du cinéaste pour recréer leur réalité. C’est à ce titre que la vision de certaines images de BORN FREE (dont nous ne voyons tout compte fait que quelques scènes finalisées durant le documentaire), qu’elles soient muettes ou exemptes de tout commentaire, peut se révéler glaçante en ce qu’elle nous éclabousse de fragments de réalités perturbantes où la parole devient superflue.
Après avoir vu THE ACT OF KILLING, on peut se remémorer un extrait d’un discours de sinistre mémoire de Heinrich Himmler :
« La plupart d’entre vous savent ce que cela signifie quand 100 cadavres sont alignés les uns à côté des autres, quand il en a 500 ou quand il y en a 1000. Avoir tenu bon face à cela – abstraction faite de faiblesses humaines exceptionnelles – et être resté correct pendant ce temps-là, cela nous a rendus durs. C’est une page glorieuse de notre histoire, une page qui n’a jamais été écrite et qu’il ne faudra jamais écrire ».
Cette page d’histoire, Anwar Congo, Herman Koto et leurs complices, eux, ont tenté de l’écrire avec bonne conscience, fierté et diligence. Elle n’aura rien de glorieux en définitive…
À voir de toute urgence !
Téléchargez les anciens numéros de Sueurs Froides
Inscrivez-vous à la liste de diffusion et accédez au
téléchargement des anciens numéros de Sueurs Froides :
- Une tranche d'histoire du fanzinat français
- 36 numéros de 1994 à 2010
- Près de 1800 films critiqués
Un index est disponible pour chercher un film ou un dossier
CLIQUEZ ICI.
- Article rédigé par : Patrick Barras
- Ses films préférés : Il était une fois en Amérique, Apocalypse now, Affreux, sales et méchants, Suspiria, Massacre à la tronçonneuse