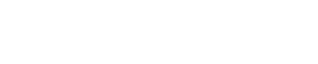The Neon Demon
C’est une évidence de dire qu’avec THE NEON DEMON, Winding Refn n’a pas rendu la tâche du critique aisée. Présentée au festival de Cannes, la dernière oeuvre de Refn a profondément divisé : entre accusation de racolage prétentieux, chic vulgaire ou proclamation au génie électrisant, c’est la foire d’empoigne, dispute encore relayée par le petit succès de l’oeuvre dans les salles. THE NEON DEMON, c’est d’abord un pitch qui cumule avec un aplomb remarquable les clichés de la mode et les clins d’oeil opportunistes ou racoleurs. Jesse, une jeune provinciale âgée seulement de 16 ans débarque à Los Angeles pour réussir dans la mode, univers à la mesure du Texas de DALLAS, c’est-à-dire sans pitié. La récriture de la fiction arriviste en milieu cinématographique (ALL ABOUT EVE, Mankiewicz ; THE PLAYER, Altman) ou de la success story dramatique (UNE ÉTOILE EST NÉE, Cukor) a pris les atours ici plus modernes d’un chic photogénique et léché, celui de la mode haut de gamme, de ses créateurs et photographes stars. L’innocence de Judy Garland dans UNE ÉTOILE EST NÉE s’est ici métamorphosée en paysage psychique plus incertain : en faisant incarner Jesse par Elle Fanning qui a troqué son dentier dans TWIXT pour une beauté diaphane et fragile, Refn passe de la perversion spectrale à une forme de pédophilie à la fois plus consciente et provocatrice. Premier problème du film qui touche à son incarnation : alors que la beauté de DRIVE ou de ONLY GOD FORGIVES résidait dans l’aura – à laquelle on voulait bien croire – d’images irradiant un drame psychologique, à la manière d’une déflagration douce baignant de son crépuscule coloré un monde menaçant de tomber en ruines, THE NEON DEMON navigue entre plusieurs régimes d’images incompatibles. Celle préoccupée de réalisme qui se justifie de la jeunesse d’Elle Fanning dans son rôle de mannequin auquel personne ne résiste, celle, glacée de l’univers de la mode à Los Angeles, confinée dans des studios aseptisés indiquant à l’avance le caractère glacé des pages de magazine chic, celle enfin du drame onirique basculant entre ambiance électrique clairement soulignée par la musique de Martinez et atmosphère cauchemardesque des motels empruntée à un Lynch que Refn recopie et s’approprie sans vergogne.
D’où, second problème, une raréfaction des lieux – le motel, la boîte, le studio, la maison gardée par Ruby – et la multiplication des signes symboliques qui y sont afférents. Chaque lieu se fait ici prison et, si le film permet de prendre conscience d’un thème chez Refn, c’est bien celui de l’habitacle inhabitable ou de l’espace cellulaire, qui court de la prison de BRONSON à la voiture ou aux ascenseurs de DRIVE. Tous les espaces se referment ici en boucle, permettant l’inversion des signes qui y évoluent : la jeune fille au regard de biche apeuré devient puma aux griffes redoutables mais n’est peut-être au final qu’une victime sans défense. Dans le monde de Refn, à la manière d’un paradis jéhoviste, le mouton côtoie l’agneau et copule avec lui dans une parodie sinistre de sexualité angoissée ou joyeuse. Chaque espace enferme et étouffe, ne s’ouvrant à l’onirisme que pour en signifier plus fermement la clôture. C’est ainsi que la référence au giallo est plus à chercher du côté de la sophistication du néo-giallo dans le couple Cattet-Forzani que dans les oeuvres de Bava ou d’Argento plus libératrices dans la jouissance horrifique. De même l’ésotérisme du second est-il ici métamorphosé en une esthétique new-age (les triangles d’un prisme étalé en surface plane) appelant plus à la fascination de la marque qu’à la complexité du discours initiatique. La séquence d’un défilé rêvé, première sortie phantasmée de Jesse dans le monde de la mode, pourrait finalement valoir comme justification interne au film. L’auto-érotisme de Jesse qui s’embrasse dans tous ses reflets avoue le narcissisme d’un film et d’un cinéaste qui ne cherche pas en dehors de son oeuvre même – et d’abord chez le spectateur – une jouissance à convoquer et entretenir. D’où cette auto-satisfaction cyniquement visible dont on imagine bien combien elle peut horripiler une partie importante de la critique.
On peut laisser sans problème à Refn cette prétention à un hermétisme personnel qui n’est pas un empêchement à faire oeuvre. On peut également accepter la dissolution de la narration dans les clichés d’une diégèse de magazine réduisant en quelques clichés la complexité d’un récit. Mais là où la modernité d’un Almodovar apparaît de façon éclatante dans le travail critique qu’il opère du cliché, Refn se montre plutôt stérile dans sa prétention à instiller au film le sérieux d’un tragique tout en le mêlant à une forme de grotesque. En raréfiant les personnages jusqu’à l’irréalisme le plus total – jamais Los Angeles n’a été plus vide de ses habitants -, en s’appuyant sur une grammaire narrative qui paraît quelque peu éculée avec ses coups de théâtre téléphonés, en saturant espace sonore et espace lumineux jusqu’à supprimer toute possibilité de lecture interprétative, Refn en fait trop et trouve sa limite au moment même où il tente d’abolir les barrières de la représentation cinématographique.
Il pourrait être tentant enfin de ramener l’ensemble à une forme de matérialisme pur, à l’indéfini de l’angoisse provoqué par la généralisation de l’image numérique et de ses corps trop brillants et trop parfaits dans lesquels l’humain s’asphyxie à force d’immobilisme. On respirait encore dans DRIVE, à des moments de stase amenés par des changements rythmiques qui étaient autant de relâchements possibles. On étouffe ici, englué dans l’épaisseur de ses lumières trop blanches, de ces éclairages écrasants, on se noie dans des piscines vidées de leur contenu et on s’écrase à la suite d’une ascension vertigineuse mais rêvée. On retrouvait déjà cette transcendance factice, artificielle et grotesque dans le MA LOUTE de Dumont. Symptome de l’époque ? Mais l’esprit parodique de Dumont s’est figé ici dans la pose d’un rictus et dans l’évocation d’une vanité future. Dans THE NEON DEMON, la rigidité des vedettes posant devant les objectifs sent déjà les cadavres sur lesquels Ruby, la maquilleuse thanatopracteuse, se masturbe. Les thèmes du vampirisme et de la nécrophilie auraient pu conduire le réalisateur à uen forme de fantastique à fleur de peau. Las, Refn a préféré en faire le signe d’une célébration de sa propre pratique. Le héros de DRIVE, petit malfrat héroïsé par l’amour, maquillait des voitures pour les transformer en carosse de conte de fée, le temps d’une promenade idyllique. Refn maquille désormais son propre cinéma et celui des autres pour en faire des momies rutilantes mais anémiques. On étouffe sous la couche de fard. Cette beauté est un masque plaisant mais vide qui n’a à offrir que les craquelures d’un paysage désertique à la place des rides du vivant. Piètre victoire que celle qui remplace la pauvreté lumineuse du monde par son emphase surjouée. THE NEON DEMON, c’est en somme la boursouflure sublime d’un selfie.
Téléchargez les anciens numéros de Sueurs Froides
Inscrivez-vous à la liste de diffusion et accédez au
téléchargement des anciens numéros de Sueurs Froides :
- Une tranche d'histoire du fanzinat français
- 36 numéros de 1994 à 2010
- Près de 1800 films critiqués
Un index est disponible pour chercher un film ou un dossier
CLIQUEZ ICI.
- Article rédigé par : Stéphane Bex
- Ses films préférés :