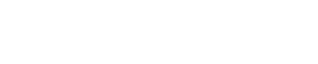Love streams
Robert, écrivain alcoolique et désabusé, passe son temps à tromper son ennui en collectionnant les conquêtes, jeunes de préférence. Sarah quant à elle, femme extravertie et extravagante, court après et tente de sauver les reliefs de sa vie affective et familiale. LOVE STREAMS nous donne à voir et à suivre leurs errances en parallèle avant de nous révéler la nature du lien qui les unit.
LOVE STREAMS est bel et bien le dernier film de John Cassavetes, en tant qu’auteur (car pour BIG TROUBLE, en 1986, il ne sera qu’« invité » en tant que réalisateur). En 1983, il se voit confier carte blanche par Menahem Golan (dont la firme Cannon Group n’est plus à présenter ici) pour réaliser le projet qui lui tient à cœur, quel qu’il soit. Golan est à l’époque en quête de légitimité et de respectabilité, dans un milieu qui le rejette quelque peu et a tendance à le considérer comme un fanfaron et un parvenu.
Se « payer » un auteur de la trempe de Cassavetes, puis d’autres par la suite, semble alors pour Golan le moyen idéal de parvenir à ses fins. Le réalisateur traîne tout de même la réputation d’être celui qui a mis son poing dans la gueule du producteur Stanley Kramer à qui il reprochait d’avoir dénaturé le montage de son premier film hollywoodien : UN ENFANT ATTEND. Geste qui lui vaudra sa mise à l’écart de Hollywood mais aussi sa fameuse réputation d’intransigeance et d’indépendance farouche. Ce n’est donc qu’en ayant obtenu du producteur la relative assurance qu’il mettra bien en scène un film indépendant (financé par un autre…) qu’il se lancera dans l’aventure.
LOVE STREAMS sera donc estampillé du sceau de la « méthode Cassavetes » : Réalisé en grande partie au sein de la « famille » qu’il a fondée au fil des années et des réalisations, quitte à évincer une partie du personnel « suggéré » par Golan (à commencer par le chef opérateur) au profit de proches, tourné dans la maison même des Cassavetes. Une grand partie du tournage est empreinte d’hésitations qui mèneront à des réécritures de nombre de scènes qui peuvent faire penser à une improvisation, mais qui chez l’auteur est vraiment la marque d’une spontanéité axée sur une découverte progressive de ce qu’il souhaite raconter et mettre en scène. Cependant, l’aventure sera marquée mais paradoxalement enrichie par des éléments funestes, comme le décès de la mère du réalisateur ou la découverte de sa propre maladie, qui finira par avoir raison de lui quelques années plus tard, et la fatigue qui en découle. Éléments propres à donner au métrage une coloration très personnelle, pour ne pas dire autobiographique quand on s’appelle Cassavetes.
Le thème qui sous-tend le film, comme le titre le souligne suffisamment et comme Cassavetes l’affirmera à l’envi, c’est l’amour. Celui que l’on a en trop plein, comme celui que l’on ne parvient pas à exprimer et que l’on cache, celui que l’on perd, aussi. Le trop plein est pour Sarah / Gena Rowlands qui a tellement d’amour à distribuer et à clamer autour d’elle, dans toutes les directions, avec une frénésie qui dénote d’une personnalité quasiment borderline, qu’elle en vient à négliger sa propre famille et qu’elle perd celui de son mari et de sa fille.
Robert / John Cassavettes, quant à lui, semble le fuir ou l’enfouir en lui, excepté sous sa forme physique et de manière compulsive, qu’il s’assure à coup des volées de chèques dispensés sans compter. Il est tellement enfermé dans son personnage de séducteur blasé, revêtu la plupart du temps d’un smoking qui de manière emblématique finit par apparaître comme une armure ou un costume de scène, qu’il lui est devenu impossible de manifester son amour à son propre fils, qu’il n’a jamais connu et qui lui est confié durant un week end. Sa retenue et sa méfiance le conduisent à se disperser et à se perdre dans une forme d’autodestruction dont il porte avec nonchalance les stigmates – blessures résultant de ses beuveries ou traces de corrections reçues à l’occasion.
Ce n’est qu’aux deux tiers du métrage que nous apprenons que Robert et Sarah sont frère et sœur, après que le film nous les laisse posément découvrir, dans une suite de longues séquences/tableaux censés prendre le temps de camper les deux personnages et donner à appréhender leur psychologie respective. Tableaux juxtaposés dans un montage parallèle qui s’achève quand Sarah, de retour d’un voyage « thérapeutique » suggéré par son psy, vient habiter chez Robert et que le réalisateur nous laisse alors tranquillement spéculer sur la nature exacte de leur relation.
Un thème sous-jacent du film est également la solitude qui habite les deux (anti) héros. Solitude qui résulte de leurs conceptions respectives et opposées de l’amour et qui finit par les réunir. Une solitude que Sarah cherche à fuir et dans laquelle s’enferme de plus en plus ce frère qu’elle adore, dont elle cherchera à le sortir à tout prix. À ce propos, nombre de plans acquièrent une dimension emblématique grâce à l’utilisation que fait le réalisateur de la lumière en intérieur : La solitude de Robert se voit souvent rattachée à l’obscurité et l’apparition de Sarah qui tente de le rejoindre introduit alors la lumière au sein de ces plans.
Que l’on aime ou non (c’est peut être après tout une question d’âge…) les histoire que Cassavetes nous raconte, on ne peut de toute façon qu’être conquis par l’intelligence qui guide la construction et la composition de chaque scène ou plan. Il faut probablement une certaine maturité pour apprécier ce film (et l’œuvre de l’auteur en général), à moins qu’il ne puisse nous aider à en acquérir un peu, comme la vie elle-même, lentement, patiemment…
Avec sa durée de 2h 20, LOVE STREAMS reste le film d’un auteur qui sait prendre son temps, quand bien même il pressent qu’il n’en a plus forcément beaucoup devant lui. Grâce à lui Menahem Golan (qui pour la petite histoire ne mit que deux fois les pieds sur le plateau, les rapports instaurés avec lui par Cassavetes ayant été purement formels et distants) pourra se targuer d’avoir obtenu l’ours d’or à Berlin en 1984.
Pour le reste, le film est absolument à regarder en VO, tant l’unique doublage Français pour la télé constitue une véritable punition et fait sombrer bon nombre de scènes dans le ridicule. On peut également faire durer le plaisir en visionnant I’M NOT ALMOST CRAZY, le documentaire sur le tournage réalisé par Michael Ventura.